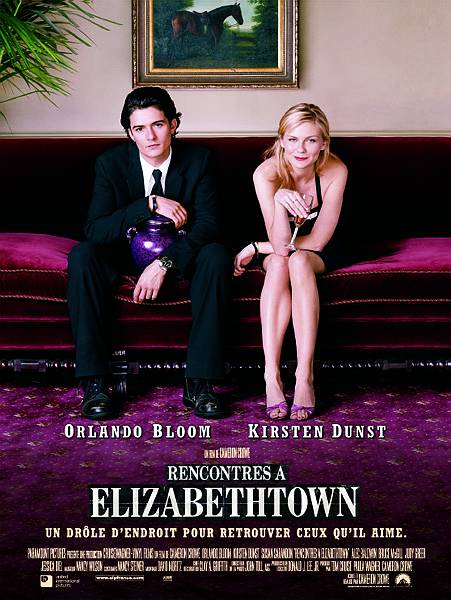
Genre : Comédie, Romance
Date : 2 Novembre 2005
Durée : 2 h
Origine : Américain
Distribution : Paramount Pictures / United International Pictures
Titre original : Elizabethtown
Acteurs :
Orlando Bloom : Drew Baylor
Kirsten Dunst : Claire Colburn
Susan Sarandon : Hollie Baylor
Alec Baldwin : Phil DeVoss
Bruce McGill : Bill Banyon
Judy Greer : Heather Baylor
Jessica Biel : Ellen Kishmore
Paul Schneider : Jessie Baylor
Loudon Wainwright III : Oncle Dale
Gailard Sartain : Charles Dean
Jed Rees : Chuck Hasboro
Paula Deen : Tante Dora
Dan Biggers : Oncle Roy
Alice Marie Crowe : Tante Lena
Tim Devitt : Mitch Baylor
Ted Manson : Sad Joe
Maxwell Steen : Samson
Reid Steen : Samson
Shane Lyons : Charlie Bill, le gamin ébloui
Emily Rutherfurd : Cindy Hasboro
Michael Naughton : un autre cousin
Griffin Grabow : Griffin
Nina Jefferies : Mona immobile
Emily Goldwyn : la star du basketball
Kristin Lindquist : Connie
Allison Munn : Charlotte, la réceptionniste
Tom Humbarger : le concierge du crématorium
Patty Griffin : Sharon
Gregory North : le pilote d'hélicoptère
Steve Seagren : le docker
Guy Stevenson : le 1er agent de sécurité
Jeffrey De Serrano : le 2ème agent de sécurité
Jeanette O'Connor : une assistante
Catherine McGoohan : une assistante
Sean Nepita : Mike Bohannon
Dena Decola : Debbie
David Brandt : le directeur de l'hôtel
Jenny Stewart : les gamines bruyantes
Delaney Keefe : les gamines bruyantes
Travis Howard : l'électricien
Bobby Daniels : Des
Rod Burke : Raymond
Nate Mooney : Trent
Judy Pryor Trice : la femme élégante
Jim Fitzpatrick : Rusty
Jim James : le groupe de Jessie
Two-Tone Tommy : le groupe de Jessie
Patrick Hallahan : le groupe de Jessie
Charlie Crowe : la bande à Jessie (sous le nom Charlie 'Bill'
Crowe)
Carl Broemel : le groupe de Jessie
Scott Sener : le groupe de Jessie
John Sullivan : les anciens d'Elizabethtown
Sonny King : les anciens d'Elizabethtown
Erwin Russell Marlowe : les anciens d'Elizabethtown
Michael Hatch : Drew à 6 ans
Masam Holden : Drew à 10 ans
Kelly Pendygraft : Rebecca la demoiselle d’honneur
Jennifer Woods : une demoiselle d'honneur
Alana Ball : la première demoiselle d’honneur
Russell George : Russ de chez Ernestine and Hazel’s
Jonathan K. Dowd : l'employé de la station service
Matt Rabinowitz : Frederick le gars de Florsheim
Directeur
Photo : John Toll
Musique : Nancy Wilson
Décors :
Robert Greenfield
Nancy Deren : dessinatrice décors
Maureen Farley : chef accessoiriste
Kevin Morrissey : dessinateur décors
Sean Ginevan : ensemblier
Chef décoration : Clay A. Griffith
Costumes :
Nancy Steiner : chef costumière
Trayce Gigi Field : assistante costumière
Montage :
Mark Livolsi : montage additionnel
David Moritz : chef monteur
Joe Hutshing
Effets Spéciaux :
James Reedy : superviseur effets spéciaux
Allen Hall : coordinateur
Casting :
Andrew S. Brown
Gail Levin
Barbara McCarthy
Direction artistique :
Beat Frutiger
Martha Johnston : assistante
Maquillage :
Mary L. Mastro : styliste coiffure
Maggie Fung : chef maquilleuse
Michèle Burke : création & supervision maquillages
Deborah Patino : chef maquilleuse Orlando Bloom
Susan V. Kalinowski : chef coiffeuse
Matt Dannon : styliste coiffure
Don Rutherford : maquilleuse
Son :
Jeremy Pitts : monteur bruitages deuxième équipe
Robert Deschaine : mixeur synchro deuxième équipe
Joel Dougherty : assistant monteur son
Bud Raymond : opérateur playback musique
Kerry Dean Williams : chef monteur dialogues/synchro deuxième équipe
Michele Perrone : monteuse synchro deuxième équipe
Robin Harlan : bruitages deuxième équipe
Julio Carmona : enregistrement synchro deuxième équipe
Don Coufal : perchman
David Kudell : assistant monteur son
Jeff Wexler : ingénieur
Curt Schulkey : monteur dialogues deuxième équipe
Jonathan Klein : monteur bruitages deuxième équipe
Ron Bedrosian : mixeur synchro deuxième équipe
Carlton Kaller : monteur musique
Philip Rogers : enregistrement synchro
Jeremy Peirson : monteur effets sonores deuxième équipe
Laura Graham : monteuse synchro deuxième équipe
Randy Singer : mixeur bruitages deuxième équipe
Valerie Davidson : monteur bruitages
Anna MacKenzie : monteur dialogues
Skip Lievsay : chef monteur son deuxième équipe
Paul Timothy Carden : monteur dialogues deuxième équipe
Sarah Monat : bruitages deuxième équipe
Tami Treadwell : enregistrement synchro deuxième équipe
Rick Kline : mixeur post-synchro
Jason Ruder : monteur musique
Craig Berkey : monteur effets sonores deuxième équipe
Scénario : Cameron Crowe
Producteur
:
Cameron Crowe
Tom Cruise
Paula Wagner
Production :
Cruise-Wagner Productions
Vinyl Films
Paramount Pictures
Producteur executif : Donald J. Lee Jr.
Producteur associé : Andy Fischer
Assistant réalisation :
Rebecca Stefan : second assistant seconde équipe
Scott Andrew Robertson : premier assistant
Sunday Stevens : second assistant
Robert 'Skid' Skidmore : second assistant supplémentaire
Eric Tignini : premier assistant seconde équipe
Lieux de tournage :
Kentucky, USA.
Los Angeles, Californie, USA.
Budget :
Site officiel : France : http://www.uipfrance.com/sites/elizabethtown/
USA : http://www.elizabethtown.com/home.html
Récompenses :
Festival
du Film Américain de Deauville : 2005
Avant-premières
C’est l’exploit que vient d’accomplir le designer Drew Baylor en créant la chaussure de sport Mercury, une aberration dont le lancement imminent pourrait bien être le bide du siècle, avec une perte sèche annoncée de 1 milliard de dollars.
À trois jours de l’apocalypse, Drew en est à sa deuxième tentative de harakiri lorsqu’il reçoit un appel affolé de sa soeur. Leur père, Mitch, vient de mourir, et leur mère a sombré dans un tel état de confusion et d’agitation qu’elle est incapable de se rendre dans le Kentucky pour les funérailles. Il revient à Drew de régler les détails de la cérémonie avec la famille et les nombreux amis du défunt : des gens inconnus ou perdus de vue depuis des années, qui l’admirent presque autant que leur cher Mitch et qui voient – encore – en lui le plus brillant des Baylor.
Sur le chemin d’Elizabethtown (Kentucky), Drew fait un retour sur lui-même et tente de recomposer l’image de ce père qu’il connaissait au fond si mal. Dans l’avion désert, Claire, une hôtesse enjouée, dont rien ne semble pouvoir entamer l’optimisme, le soûle toute la nuit de confidences décousues et l’entreprend sur mille sujets. Le matin, elle lui trace un itinéraire qu’elle dit infaillible : qu’il s’y conforme, et il arrivera à coup sûr à bon port. Leurs chemins se séparent alors, mais se croisent bientôt à nouveau pour quelques heures... et à nouveau. Dans l’urgence et la précarité de ces brèves rencontres, se construira quelque chose qui n’a pas encore de nom. Et Claire sera là, à ses côtés, alors même que Drew ne l’espérait plus, pour l’accompagner dans le deuil, les rires et les larmes. Pour devenir son guide à travers l’Amérique, tout le long de son délicat parcours de mémoire... et encore bien au-delà.
«Comment
dire adieu à un homme qu’on connaissait à peine de
son vivant ?»
C’est à partir de cette question, d’une résonance
toute personnelle, que le scénariste/réalisateur Cameron
Crowe choisit d’écrire Rencontres à Elizabethtown
(Elizabethtown) (2004) . Puisant une fois encore dans ses propres expériences,
Crowe s’est souvenu des émotions complexes que suscita en
lui la disparition brutale de son père. Héros de cette
tragi-comédie familiale, le jeune Drew Baylor (Orlando Bloom)
commence à découvrir réellement son père
et à en prendre la mesure dans les jours qui suivent son décès.
Obligé de faire bonne figure face à une pittoresque légion
de parents et d’amis inconnus, Drew trouve un soutien inespéré
en la personne d’une jeune hôtesse de l’air (Kirsten
Dunst), dont l’humour et l’optimisme l’aideront à
traverser une des périodes les plus difficiles de sa vie. Rencontres
à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) est un voyage, un retour
aux sources en même temps qu’une ode à l’amour,
à l’espoir et à la résilience. Poussant jusqu’au
bout l’hommage, Crowe a souhaité en faire le genre de film
que son propre père appréciait le plus : «un film
qui mêle intiment le rire et les larmes».
Paula Wagner :
«Cameron n’est pas seulement l’un des grands scénaristes-réalisateurs
de notre temps. C’est aussi un merveilleux chroniqueur de la vie
réelle, plein de malice, de charme et de générosité.
Il sait vous faire rire des faiblesses d’un personnage et, l’instant
d’après, vous arracher des larmes. Rencontres à Elizabethtown
(Elizabethtown) (2004) nous entraîne dans l’un de ses voyages
les plus personnels – un voyage qui finit par devenir le nôtre.»
Orlando Bloom :
«Cameron a le don de capter la vie, de la donner à voir
dans sa plénitude. Il nous la rend si proche, si authentique,
que l’on ne sait trop s’il faut en rire ou en pleurer.»
Kirsten Dunst :
« Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) n’est
pas qu’une comédie, ou un drame, ni une simple histoire
d’amour – c’est un film qui parle de la vie et des moments
d’intimité qui surgissent au détour d’une rencontre
entre deux personnes. Il entrecroise quantité d’histoires
différentes, sans
prétendre délivrer de message. Cela ressemble parfois
à une «tranche de vie», mais si vous y regardez de
plus près, chaque réplique, chaque action est porteuse
de sens. Cela s’appelle… un film de Cameron Crowe.»
En 1989, Crowe venait tout juste d’assister à la sortie
de son premier film : Un Monde pour nous – une sortie discrète,
jusqu’à ce que les critiques Siskel et Ebert portent aux
nues le travail de ce jeune réalisateur. Le père de Crowe
rendait visite à sa famille dans le Kentucky et partageait sa
joie à la lecture de ces louanges lorsqu’il fut terrassé
par une crise cardiaque. Ce fut un choc terrible pour Crowe, qui le
hanta durablement. Au fil des ans, la réputation de scénariste
réalisateur de Cameron Crowe ne cessa de grandir, portée
par des succès critiques et populaires comme Singles, Jerry Maguire,
Presque célèbre et Vanilla Sky.
Tous ces films avaient un rapport direct avec sa vie. Le récit
de ses années d’apprentissage à «Rolling Stone»
dans Presque célèbre en est sans doute l’exemple
le plus évident, qui devait lui rapporter l’Oscar du meilleur
scénario. Frances McDormand s’y distinguait, au sein d’une
brillante distribution, dans le rôle d’Alice, figure maternelle
hautement pittoresque à laquelle le film était dédié.
Quelques années plus tard, Cameron Crowe jugea qu’il était
temps d’honorer la mémoire de son père…
Cameron Crowe :
«Curieusement, j’ai d’abord résisté à
la tentation d’écrire des choses très personnelles
sur ma vie et ma famille. Même les livres que je lisais durant
ma jeunesse étaient rarement écrits à la première
personne. Et puis, à dix-huit ans, «Rolling Stone»
m’a commandé un article que je ne pouvais rédiger
autrement : «How I Learned About Sex». Ce fut un tournant
et une révélation. L’article rencontra un echo immédiat.
Des gens m’écrivirent, des amis et des rédacteurs
me dirent : «J’ai eu l’impression que tu racontais ma
vie». Et c’est ce qui continue de m’arriver périodiquement.
Plus l’histoire que je conte m’est personnelle, plus elle
semble intéresser les gens. Après Presque célèbre,
on m’a souvent interrogé sur mon père : «Quel
genre d’homme était-ce ? À quoi ressemblait-il ?»
Je lui avais consacré une nouvelle, intitulée «My
Father’s Highway», qui était l’une de mes favorites,
quoiqu’elle restât au fond d’un tiroir. Et puis, un
jour…» Cela se passait durant l’été 2002,
peu après la sortie de Vanilla Sky. Cameron Crowe accompagnait
sa femme, Nancy Wilson, en tournée avec le groupe Heart. Traversant
en bus le Kentucky, il fut frappé par l’extraordinaire beauté
de ces paysages et de «ces collines bleu acier» qu’il
n’avait pas revues depuis l’enterrement de son père
en 1989. Il n’en fallut pas plus pour déclencher son inspiration.
Cameron Crowe :
«J’ai lâché la tournée, j’ai loué
une voiture, je suis allé me perdre sur les routes du Kentucky
et j’ai écrit d’un jet Rencontres à Elizabethtown
(Elizabethtown) (2004) »
Ce fut un exercice chargé d’émotions intenses. Crowe
y trouva une occasion privilégiée d’évoquer
la résurrection de nos espoirs au-delà de l’échec
et du deuil et de faire défiler quantité de personnages
contrastés et hauts en couleur.
Cameron Crowe :
«J’écris fréquemment des histoires peuplées
de gens qu’on pourrait qualifier de «ratés»,
parce qu’ils sont à mes yeux d’authentiques héros.
Ils digèrent leurs échecs, les surmontent et continuent
à avancer. Ils croient en la vie, ils se veulent positifs. L’autre
option est, de toute manière, bien plus noire et beaucoup moins
plaisante.»
Dans Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) , Drew
vient d’être licencié pour le fiasco (annoncé)
d’un modèle de chaussures auquel il avait consacré
de longs mois de travail lorsqu’il apprend la mort soudaine de
son père, à l’autre bout des États-Unis. Sa
mère, bouleversée, incapable de faire face à la
situation, le charge de se rendre dans le Kentucky, d’y affronter
le reste de la famille, puis de ramener ses cendres à Portland
(Oregon). C’est durant la première phase de ce voyage mouvementé
que Drew fait connaissance avec celle que Crowe appelle «la messagère
d’amour» du film, l’hôtesse de l’air Claire
Colburn. La jeune femme s’est fixé une mission dans la vie
: apporter du bonheur aux gens, les aider à surmonter leurs problèmes.
Elle prend aussitôt en main le sort de Drew.
Cameron Crowe :
«Au début du film, Drew a essuyé un sérieux
revers professionnel, mais le drame commence vraiment avec l’annonce
de la mort de ce père qu’il a si mal connu. Comme lui, nous
espérons pouvoir un jour dialoguer avec nos parents d’égal
à égal, avoir des échanges adultes. Mais nous croyons
avoir tout le temps, et différons ou négligeons d’année
en année ces opportunités . Grâce à Claire
et sa «feuille de route» si élaborée, Drew
va enfin découvrir son père et se retrouver lui-même.
Il n’est jamais trop tard… « Rencontres à Elizabethtown
(Elizabethtown) (2004) reflète très exactement l’idée
que je m’en faisais à l’origine. Il s’ouvre par
une «fin» et se conclut sur une ouverture, et j’espère
qu’en sortant de la salle, vous vous direz : ces gens-là
vont me manquer…»
Orlando
Bloom :
«J’ai pensé dès le départ que ce serait
une histoire touchante et qu’une bonne partie du public s’y
reconnaîtrait. C’est très libérateur de voir
quelqu’un comme Drew se confronter à la vie, à la
mort, au succès et à l’échec. Cela vous montre
que nul n’échappe à ces expériences.»
Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) marque la deuxième
collaboration entre Cameron Crowe et Bloom… après un spot
de 30 secondes tourné pour GAP, avec le concours de l’actrice
Kate Beckinsale. Crowe avait été impressionné par
le comédien (qu’on ne connaissait encore que pour un petit
role dans La Chute du Faucon Noir et une participation modeste au Seigneur
des anneaux), et tous deux s’étaient promis de retravailler
ensemble. Sur les conseils du réalisateur, Bloom passa de nombreuses
heures à étudier des classiques comme Indiscrétions
de George Cukor, Les Plus belles années de notre vie de William
Wyler et, surtout, La Garçonnière de Billy Wilder, qu’il
visionna fréquemment, à l’instar de ses partenaires.
Orlando Bloom :
«Cameron me disait : «Observe bien Jack Lemmon dans ce film.
Drew a la même tendresse, et dans ses bons jours, il possède
l’élégance et la classe d’un jeune Cary Grant.»
Paula Wagner :
«Orlando est prodigieusement doué. Il investit dans le
personnage de Drew une énergie et une clairvoyance qui font du
film une expérience transcendante. Il confère une remarquable
subtilité à cet homme drôle et charmant dont l’univers
va s’ouvrir en l’espace de quelques jours, s’enrichir
à travers le souvenir de son père et sous l’influence
de Claire. Orlando a relevé avec aisance tous les défis
de cette quête intérieure pour aboutir à une magnifique
scène de catharsis qui touchera tous les spectateurs. C’est
une performance d’acteur rare, qui nous le révèle
sous un jour inédit.»
Cameron Crowe :
«Grâce à ces visions répétées
du chef-d’oeuvre de Wilder, Orlando est maintenant capable d’imiter
à la perfection Jack Lemmon! Mais son principal atout est de
posséder les qualities qui distinguent un grand acteur : une
âme, un coeur, de l’humour – et assez de sensibilité
pour nous les offrir à l’écran.»
En s’imprégnant de ces classiques, Orlando Bloom captait
du même coup l’esprit de Rencontres à Elizabethtown
(Elizabethtown) (2004) :
«Ces films ne contiennent ni effet visuel ni explosion. Ce sont
des histoires humaines qui parlent de la famille, de la vie, de la mort.
Et c’est bien dans cette veine que s’inscrit aujourd’hui
le cinéma de Cameron.» Pour le rôle de Claire Colburn,
Cameron Crowe souhaitait une présence radieuse, une femme qui
deviendrait «l’âme du film et ne serait rien d’autre
qu’un messager d’amour». Il découvrit dès
le début du tournage qu’il avait fait le bon choix avec
Kirsten Dunst :
«Elle était au diapason du rôle, extraordinairement
instinctive et juste. C’était un bonheur de travailler avec
elle.»
Kirsten Dunst :
«C’était vraiment facile d’entrer dans le rôle,
d’adopter son regard sur la vie, son altruisme, sa positivité.
Claire est un des plus beaux personages qu’on puisse proposer à
une fille de mon âge.»
Claire est une hôtesse de l’air qui prend son travail très
au sérieux :
«C’est le genre de fille qui cherche à se rendre utile
et à apporter du bonheur aux autres», poursuit Kirsten
Dunst. «Ma mère a exercé ce métier dans les
années soixante et soixante-dix. Je pense que je l’ai dans
le sang! Quant à Orlando, c’est quelqu’un de très
doué, de très sensible. Il n’est absolument pas blasé,
et nos rapports furent d’autant plus faciles que c’est un
pitre, comme moi. Nous n’avons jamais essayé de nous la
jouer cool, tout s’est passé de la manière la plus
simple. Je n’avais encore jamais travaillé avec un réalisateur
qui s’implique à ce point dans mon travail d’actrice.
Cameron crée sur le plateau une ambiance détendue qui
vous met en sécurité.
Je me suis sentie soutenue par lui aussi bien que par l’ensemble
de l’équipe.»
Paula Wagner :
«Kirsten livre une interprétation sans faille, profondément
honnête, de Claire. Elle n’est pas seulement une professionnelle
accomplie mais une actrice naturellement douée qui s’attache
à mettre à nu la vérité intime de ses rôles.
Elle crée ici un personnage totalement original, que vous avez
l’étrange impression de connaître depuis toujours.
Ou, pour paraphraser Claire :
«une fille impossible à oublier, mais dont on a du mal
à se souvenir».
Cameron Crowe confia à Susan Sarandon le rôle d’Hollie,
la mère récemment divorcée de Drew :
«Hollie Baylor est une femme de chair et de sang en même
temps qu’une cérébrale lancée dans une quête
incessante de savoir et de vérité.
Susan Sarandon est une icône. Elle éveille chez le spectateur
des émotions fortes, elle tisse avec lui des liens si profonds
que ses personnages en deviennent inoubliables.»
Hollie réagit en deux temps à la mort de son mari, Mitch.
Elle commence par s’effondrer, obligeant Drew à régler
toutes les démarches à sa place. Puis, elle resurgit,
contre toute attente, dans la dernière partie du film pour affirmer
avec un humour robuste sa détermination à ne pas se laisser
abattre.
Susan Sarandon :
«C’est une femme solide. On sent qu’elle arrivera à
surmonter l’épreuve. J’adore son punch. Cameron a écrit
un beau rôle et ce fut un bonheur de travailler avec lui sur ce
film où il s’était passionnément investi.
Je lui suis reconnaissante de m’avoir fait participer à
ce voyage… et de m’avoir permis de dévoiler mes fabuleux
talents de danseuse de claquettes!»
Les rôles «secondaires», richement étoffés,
sont tenus par des acteurs de premiers plans – vétérans
consacrés et nouveaux venus aux talents prometteurs.
Alec Baldwin interprète Phil, le patron pseudo-zen et faussement
paternel de Drew, qui le saque sans état d’âme pour
le fiasco annoncé de sa firme.
Jessica Biel incarne Ellen, la petite amie de Drew, qui le plaque froidement
à quelques jours de ce désastre financier.
L’acteur de composition Bruce McGill joue Bill Banyon, un ancien
ami de Mitch, qu’Hollie déteste cordialement et soupçonne
d’escroquerie.
Judy Greer interprète Heather, la soeur hyper-stressée
de Drew, qui subit de plein fouet l’accès dépressif
de leur mère. Fan de l’actrice, Crowe ne put que se réjouir
de la qualité de ses scènes avec Susan Sarandon :
«Elles forment un merveilleux tandem, drôle et authentique
à la fois.»
Après avoir vu All the Real Girls, Crowe choisit Paul Schneider
pour interpréter Jessie Baylor, le cousin de Drew qui sert à
ce dernier de guide dans le maquis familial. Père célibataire,
aux prises avec un incorrigible gamin de cinq ans, Jessie est habité
par un rêve : relancer le groupe rock de ses années de
lycée, Ruckus. Pour initier Schneider à la scène
musicale du Kentucky, Cameron Crowe lui demanda de participer à
une tournée du groupe local My Morning Jacket.
Crowe et sa fidèle directrice de casting Gail Levin sélectionnèrent
pour les petits rôles un échantillon pittoresque, comprenant
des personnalités aussi diverses que Paula Deen, présentatrice
de l’émission «Paula’s Home Cooking» sur
Food Network, dans le rôle de Tante Dora ; l’auteurcompositeur-
interprète Loudon Wainwright, dans le rôle d’Oncle
Dale ; la propre mère du cinéaste, Alice Marie Crowe,
dans celui de Tante Lena ; sans oublier des musiciens comme Patty Griffin
(Sharon), Charlie Crowe (cousin de Cameron) et les membres de My Morning
Jacket, qui incarnent le groupe fictif Ruckus.
La musique
joue, comme dans tous les films de Cameron Crowe, un rôle vital
dans Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004)
Cameron Crowe :
«J’écris très souvent en musique et effectue
très tôt la présélection des airs qui figureront
dans la BO. Je dresse de longues listes dans un classeur qui finit par
avoir l’épaisseur d’un script, et il m’arrive
d’avoir cinquante idées de chansons pour une seule et même
scène. Mais le moment le plus jouissif est celui où je
découvre, au montage, que mon choix était le bon.»
Paula Wagner :
«Cameron a une connaissance encyclopédique de la musique
de notre temps et le don de la marier de façon inoubliable à
ses images.
Ses musiques reflètent à la perfection l’essence
de la scène, qu’il y soit question d’amour, de douleur,
de deuil ou de rédemption.»
La musique est également très présente sur le plateau,
car, avant une prise, Crowe fait presque toujours jouer la chanson qui,
selon lui, traduit le mieux l’émotion du moment et peut
aider le comédien à capter l’essence de la scène
ou du personnage.
Le réalisateur découvrit avec plaisir que ses deux vedettes
avaient adopté la meme démarche : «Kirsten et Orlando
sont fans de musique et s’en remplissent les oreilles pendant des
heures. Ils avaient téléchargé quantité
de titres géniaux qu’ils se faisaient découvrir réciproquement
– d’où leurs fréquents retards aux répétitions!»
«Cameron fait souvent jouer de la musique sur le plateau»,
ajoute Orlando Bloom, «ce qui est tout à fait normal, puisqu’il
écrit en musique et a constamment une musique, un rythme en tête.»
Dès le casting, Cameron Crowe fit ainsi jouer un air de Tom Petty
: «It’ All Work Out», qu’il se passait déjà
en travaillant au personnage de Claire.
Cameron Crowe :
«Nous l’avons joué lors de notre première rencontre
avec Kirsten et cela collait si bien à son personnage que nous
en avons fait le theme de Claire.»
«My Father’s Gun» d’Elton John est un autre morceau-clé
de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) Il accompagne
la scène où Drew se recueille pour la première
fois devant la dépouille de Mitch, et est repris durant son voyage
final.
Cameron Crowe :
«L’album «Tumbleweed Connection» dont est extrait
cet air est l’un des plus appréciés d’Elton
John, et cette composition en est un titre phare. Elton nous donne ici
sa vision de l’Amérique, de la famille, de ses origines.
C’est son Elizabethtown, et je lui suis profondément reconnaissant
de m’avoir autorisé à utiliser «My Father’s
Gun». C’est une de mes chansons favorites, qui commence sur
une discrète note de mélancolie et se mue en une célébration
de la vie – tout comme le personnage de Claire.»
La dernière portion du film est aussi la plus riche en musiques.
Durant cette longue séquence, Drew écoute en continu la
compilation que Claire lui a préparée pour accompagner
son voyage et favoriser son dialogue post-mortem avec Mitch. La scène
contient des airs de styles très contrastés, qui en sous-tendent
l’émotion et illustrent l’éclectisme et la culture
musicale encyclopédique de Cameron Crowe.
Épouse et collaboratrice régulière de Crowe, la
co-fondatrice du groupe Heart Nancy Wilson a écrit la partition
de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) et signé
plusieurs des chansons originales de la BO. Depuis 1989, elle a participé
en tant qu’auteur, compositrice et/ou interprète à
tous les films du réalisateur.
Cameron
Crowe :
«À l’époque, déjà lointaine,
où je travaillais à «Rolling Stone», je rencontrais
souvent en tournée des fans de l’Arkansas, du Texas ou de
l’Oklahoma, qui me demandaient «Mais pourquoi ton magazine
ne parle-t-il jamais de nous ni de notre région ?» En écrivant
Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) j’avais
aussi le désir d’évoquer des gens qui ne sont ni
de New York, ni de Los Angeles, ni d’aucune de ces métropoles
connues de tous. Et je me suis dit : «Parlons un peu d’Elizabethtown.»
Cameron Crowe tenait tout particulièrement à filmer au
Kentucky durant les mois d’été pour capter la chaleur
écrasante et l’humidité qui règnent en cette
saison et qui imprègnent l’histoire. La quasi-totalité
des interprètes principaux découvraient cette région
pour la première fois et furent très vite sensibles à
son ambiance si particulière.
Elizabethtown se situe à une soixantaine de kilomètres
de Louisville. La ville, semblable à tant d’autres, n’a
aucune incidence sur l’intrigue, mais son nom plaisait au réalisateur
: «Cela sonnait bien à mon oreille. En outre, elle se situe
à mi-chemin de Louisville et Nashville (Tennessee), ce qui favorisait
le deuxième rendez- vous de Drew et Claire, ce double voyage
qu’ils accomplissent l’un vers l’autre.»
L’équipe passa six semaines dans le Kentucky. Basée
à Louisville, elle filma certaines des scènes les plus
importantes dans les environs de cette ville, ainsi qu’à
Lexington.
Crowe, qui s’était fait d’emblée une idée
précise du look de Rencontres à Elizabethtown (Elizabethtown)
(2004) et son chef décorateur, Clay Griffith, cherchèrent
fréquemment leur inspiration dans l’oeuvre de Norman Rockwell
et les photos de Robert Frank, Elliott Erwitt et Gary Winogrand, qui
ont si brillamment capté l’âme de l’Amérique
profonde et son histoire, des années cinquante aux années
soixante-dix.
Le directeur photo John Toll, qui avait déjà tourné
Simpatico dans le Kentucky, fut ravi d’y retourner : « Rencontres
à Elizabethtown (Elizabethtown) (2004) est ma troisième
collaboration avec Cameron. Je sens que c’est celle pour laquelle
nous étions idéalement faits l’un et l’autre.»
Pour le grand voyage final de Drew, l’équipe fut «réduite»
à une centaine de techniciens et sillonna en six jours quatre
états : le Tennessee (avec arrêts à l’Arcade
Restaurant, niciens et sillonna en six jours quatre états : le
Tennessee (avec arrêts à l’Arcade Restaurant, à
l’Earnestine and Hazel’s Blues Bar et au National Civil Rights
Museum), l’Arkansas (pour une visite au gigantesque Dinosaur World
d’Eureka Springs et une traversée du fameux Beaver Bridge),
l’Oklakoma (pour une visite au National Memorial, érigé
en hommage aux victimes de l’attentat du 19 avril 1995 contre l’Alfred
P. Murrah Federal Building) et le Nevada.