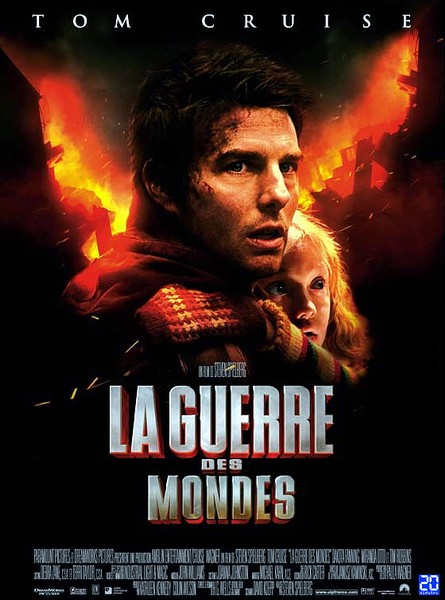Genre : Fantastique, Drame
Date : 06 Juillet 2005
Durée : 1 h 56
Origine : Américain
Distribution :
Titre original : War of the Worlds
D'après le roman de : H.G. Wells
Résumé | Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget
Tom Cruise : Ray Ferrier
Dakota Fanning : Rachel
Justin Chatwin : Robbie
Tim Robbins : Harlan Ogilvy
Miranda Otto : Mary Ann
Yul Vazquez : Julio
Lenny Venito : Manny le mécano
Lisa Ann Walter : un barman
Gene Barry : Grand-père
David Alan Basche : Tim
Rick Gonzalez : Vincent
Michael Brownlee : un reporter TV à Osaka
Camillia Sanes : le producteur du journal télévisé
Marlon Young : le caméraman des infos
John Eddins : le conducteur du van TV
Peter Gerety : le patron de Hatch
David Harbour : un docker
Miguel Antonio Ferrer : le voisin brésilien
January LaVoy : la femme du voisin brésilien
Stephen Gevedon : le voisin avec la tondeuse
Julie White : une femme
Rafael Sardina : l'assistant du mécanicien
Amy Ryan : un voisin
Ed Vassallo : les gars de l'intersection
Michael Arthur : les gars de l'intersection
Danny Hoch : le flic de l'intersection
Sharrieff Pugh : l'homme qui étudie la rue
Erika LaVonn : un photographe
Christopher Evan Welch : un photographe
John Michael Bolger : un homme qui emmène une femme
Omar Jermaine : un homme qui emmène une femme
Robert Cicchini : un gars en costume
Jim Hanna : un chauffeur de bus
Tracy Howe : un passant dans la foule
Adam Lazarre-White : un passant dans la foule
Vito D'Ambrosio : un passant dans la foule
Laura Zoe Quist : un passant dans la foule
Ana Maria Quintana : un passant dans la foule
Lorelei Llee : un passant dans la foule
Mark Manley : un ouvrier du ferry
John Scurti : le capitaine du ferry
Becky Ann Baker : une volontaire
Mariann Mayberry : une mère
Ty Keegan Simpkins : un petit garçon de 3 ans
Jerry Walsh : le gars malin
Tommy Guiffre : la Garde Nationale
Daniel Franzese : la Garde Nationale
Ed Schiff : le vieil homme
Amy Hohn : une femme lors de la panique
Dan Ziskie : un gars qui informe
David Conley : le gars informé de la maladie
Daniel Eric Gold : le gars de la conspiration
Maggie Lacey : la mère énervée
Eric Zuckerman : le gars de Doomsday
Daniel A. Jacobs : un jeune homme
Joaquin Perez-Campbell : le jeune soldat du tank
Dendrie Taylor : la mère bien pensant
James DuMont : le père bien pensant
Travis Aaron : les soldats de la guerre des mondes
Benny Ciaramello : les soldats de la guerre des mondes
Ricky Luna : les soldats de la guerre des mondes
Columbus Short : les soldats de la guerre des mondes
Kent Faulcon : les soldats de la guerre des mondes
Kevin Collins : les Majors de la Marine
Jorge Pallo : un soldat
Suanne Spoke : une femme d'affaires
Kirsten Nelson : une femme d'affaires
Melody Garrett : une femme âgée
Lauri Johnson : une femme âgée
Takayo Fischer : une femme âgée
Shanna Collins : les jeunes
Elizabeth Jayne Hong : les jeunes
Art Chudabala : un gars en basket
Jeffrey Hutchinson : un gars en basket
Dempsey Pappion : un gars en basket
Chris Todd : un gars en basket
Johnny Kastl : les soldats à Boston
Juan Carlos Hernandez : les soldats à Boston
John N. Morales : les soldats à Boston
Morgan Freeman : le narrateur
(voix)
Roz Abrams : elle-même
Ellen Barry : la femme d'en haut
Clay Bringhurst : un pilote de l'Airforce
Kevin Collins : les Majors de la Marine
Bruce W. Derdoski Jr:. les soldats à Boston
Asha R. Nanavati : une femme dans la foule
Ann Robinson : Grand-mère
Terry Thomas : les Majors de la Marine
Directeur
Photo : Januz Kaminski
Musique : John Williams
Décors : Anne Kuljian
Chef décoration : Rick Carter
Costumes : Joanna Johnston
Montage : Michael Kahn
Effets Spéciaux :
David Blitstein : superviseur
Robert L. Anderson : chef d'équipe
Damacio Cortez Jr:. fabriquant des moulages
Todd Jensen : chef d'équipe
Sara R. Morris : acheteur
Andrew Mortelliti : équipe de New York
Robert L. Olmstead : chef d'équipe
Charli Palazzo : peintre
William A. Pancake Jr:. technicien
Gintar Repecka : chef d'équipe
Neil Saiger : chef d'équipe
Daniel Sudick : coordinateur
Chris Wolters : maquillage
Leonel Zapien : services manuel
Dennis Muren : superviseur senior
Stan Winston
Effets visuels :
Pablo Helman : superviseur (ILM)
Randy Dutra : superviseur animation (ILM)
Daniel Sudick : coordinateur
Dennis Muren : supervieur senior
Casting :
Terri Taylor
Debra Zane
Direction artistique :
Andrew Menzies
Tom Warren
Tony Fanning
Edward Pisoni
Maquillage :
Lois Burwell : chef département maquillage
Rob Hinderstein : effets spéciaux maquillage (Harlow FX)
Kenny Myers : artiste maquillage
Karen Asano-Myers : superviseur coiffures foule (Los Angeles)
Marc Boyle : styliste coiffure
Leo Corey Castellano : artiste maquillage
Linda Grimes : chef département maquillage (New York)
Joel Harlow : artiste maquillage effets spéciaux (Harlow FX)
Tina Harrelson : artiste maquillage
David Larson : styliste coiffure (Los Angeles)
Joe Rossi : artiste maquillage
Rick Stratton : artiste maquillage
Jennifer Webb : coordinateur maquillage et coiffure
Angie Wells : artiste maquillage
Hiroshi Yada : département modélisme (Stan Winston Studios)
Son :
Michael Babcock : créateur sons
Anna Behlmer : mixeur post-synchro
James Bolt : co-mixeur post-synchro
Michael J. Broomberg : bruiteur
Derek Casari : ingénieur
Bryan Clements : équipe département musical
Rob Cunningham : technicien nouvelles prises
Colette Dahanne : mixeur versions étrangères
Mark Eshelman : équipe département musical
John P. Fasal : enregistreur effets sonores
Will Files : assistant designer
Christopher Flick : superviseur montage bruitage
Laura Graham : monteur synchro
Craig Heath : enregistrement
Ron Judkins : mixeur
Richard King : créateur sons
R.J. Kizer : monteur superviseur adr
Greg Loskorn : technicien musique
David Lucarelli : ingénieur adr
Michael Magill : monteur dialogues
Stuart McCowan : dialogues étranger (italiens)
Adam Michalak : enregistrement musical
Michael W. Mitchell : montage effets sonores
Piero Mura : montage effets sonores
Shawn Murphy : mixeur musique
Peter Myles : monteur musique
Andy Nelson : mixeur post-synchro
Eric Potter : enregistreur effets sonores
Charleen Richards : mixeur
Aaron Rihel : sons quotidiens
Monique Salvato : assistant adr
Hamilton Sterling : créateur sons
Scott Stolz : mixeur
Randy Thom : créateur sons
Hugo Weng : monteur dialogues
Robert Wolff : équipe département musical
Josh Friedman
Producteur
:
Colin Wilson
Kathleen Kennedy
Production :
C/W Productions
DreamWorks Pictures
Paramount Pictures
Amblin Entertainment
Producteur executif : Paula Wagner
Assistant réalisation :
James Kerwin : réalisateur seconde équipe
Adam Somner : premier assistant
Ian Stone : second assistant
Velvet Andrews : assistant réalisateur
Vic Armstrong : réalisateur seconde équipe
Craig Miller : second assistant seconde équipe
Darin Rivetti : premier assistant seconde équipe
Jennifer Truelove : second assistant (New York)
![]() Site
officiel : France
: http://www.uipfrance.com/sites/guerredesmondes/
Site
officiel : France
: http://www.uipfrance.com/sites/guerredesmondes/
Oscar 2006
Nomination Meilleur son : Andy Nelson , Anna Behlmer , Ron Judkins
Nomination Meilleur montage sonore : Richard King
Nomination Meilleurs effets visuels : Pablo Helman , Randy Dutra , Daniel
Sudick , Dennis Muren
| Note production | Acteurs
| Scénario | Producteur
| Site Officiel | Récompenses
| Lieux | Budget
Adapté du fameux roman de H.G. Wells, le dernier Spielberg est bien plus qu'un feu d'artifice de pixels éclatants et crépusculaires. S'attachant à la figure d'un père, Tom Cruise, Spielberg le ramène à la condition d'un enfant ignorant et impuissant devant les événements à venir. Le père, le fils, l'acteur, le spectateur, fusionnent dans une conscience commune un peu totalitaire, mais qui a le grand mérite de faire émerger un "nous".
Dans La Guerre des mondes, Tom Cruise protège et sauve Dakota Fanning (sa fille) d'une invasion extra terrestre. L'histoire est connue, c'est celle de H.G Wells, à quelques détails près. Justement, les détails, c'est ce qui fait toujours la différence. Pour Steven Spielberg (et pour Wells aussi), La Guerre des mondes est une fable. Une fable sur la grandeur et la petitesse de l'humain, son intelligence et sa capacité d'adaptation à un monde maîtrisé, la nature (pour les grandes lignes, mettons l'ouverture et la conclusion de l'œuvre). Seulement il y a un autre sujet dans cette version pixelisée de La Guerre des mondes.Ce sujet, pas très original, surtout chez Spielberg, c'est la responsabilité du père. Tom Cruise est divorcé, immature, irresponsable, et ses enfants (Dakota Fanning et Justin Chatwin) sont presque sérieusement plus adultes que lui. La Guerre des mondes sera donc une conquête du rôle du père grâce aux évènements, ou comment assumer ses responsabilités et accepter un devenir adulte au regard de ses enfants. Presque un film sur le choix, une parabole de ce qui fait l'une des spécificités de l'humain. Caricature d'une mythologie américaine propre à la cellule familiale comme fondement social de l'être ? Pas tant que ça. La force de Spielberg, c'est qu'en choisissant de faire de La Guerre des mondes un film intimiste à la première personne, le cinéaste organise l'évolution du récit en fonction d'une découverte progressive et individuelle des évènements. Cette découverte, associée au point de vue de Tom Cruise, permet de créer un personnage de père qui n'en sait pas plus que les autres, se retrouvant dans l'incapacité de fournir toute explication, alors que nous, spectateurs, savons déjà. Le père est donc ce même enfant désarmé que les siens, un être démuni mais qui par son seul savoir (à peine plus que son fils) peut faire la différence en organisant une fuite.
Ce jeu propre aux informations données dévoile une conscience naïve du héros qui, justement parce qu'il nous place du point de vue de celui qui subit et observe l'inédit, trouve une certaine foi dans un récit auquel Spielberg demande de croire avec le regard de l'enfant. Cette mise en récit qui défait et tente d'organiser aussi la question de l'héroïsme (avec ses références rares mais explicites à l'actualité), Spielberg la filme comme une version longue et recontextualisée de son débarquement en Normandie dans Il faut sauver le Soldat Ryan. En ce sens, La Guerre des mondes est un film presque fullerien. Ce qui compte ici c'est survivre, sauver sa peau, Tom Cruise n'ayant comme seule gloire que d'avoir sauvé sa fille et non l'humanité (ce qui est déjà beaucoup). Un film individualiste, donc ? Par moment, une scène comme l'attaque de la voiture assaillie par une centaine d'individus désespérés (rappelant presque le remake de Zombie) aurait tendance à le suggérer. Mais Spielberg ne se défait jamais d'une conscience collective. Si La Guerre des mondes joue d'une mise en scène très « actualité » (encore un trait façon Fuller), en suivant au plus près l'affolement de son héros (psychologiquement, physiquement), c'est pour faire de ce « je » (Tom Cruise) une page vierge.
Le « je » Tom Cruise n'est donc que le miroir d'une stratégie classique propre à l'éveil d'une pensée de masse. Ce « je », individu, Monsieur Tout-le-monde, acteur et observateur de l'apocalypse, traversant un enfer peuplé de visions numériques époustouflantes, Spielberg le veut comme un « nous ». « Spielberg (…) veut convaincre avant de discuter. Il y a là quelque chose de très totalitaire », a dit un jour Godard. Avec La Guerre des mondes, Spielberg ne discute toujours pas, il détruit d'abord. Inventant mille manières sidérantes pour placer l'humain dans des décors hostiles, il cherche la panique, l'étouffement, l'excitation de la perte (père-enfants). Traquant implacablement la peur au bord d'un raccord ou au détour d'un plan, sa stratégie est celle d'un totalitarisme de l'œil. Ainsi la salle, ce « nous » pensant-sentant Tom Cruise, prise dans un déluge poétique de pixels à la beauté crépusculaire, se trouve à position égale de l'acteur pris dans le filet implacable de Spielberg. On tente de se rassurer, on ne parle pas ou à peine, on reste fasciné, fatigué ; le spectacle est total, massif, et Tom Cruise reflète un spectateur ramené à lui-même face à une machine plus forte que lui. Le cinéma, « contrôle de l'univers » disait Godard, voudrait inviter ici à une conscience de soi par les sens, l'émotion. Il demande à croire en nous, seuls acteurs d'un monde existant d'abord par le souci de l'autre dont il faut simplement assurer la survie. L'épitaphe s'écrit enfin au nom de Dieu et à la gloire de la nature, mais devant la désolation des paysages anéantis, l'homme n'a que lui-même, il est seul.La Guerre des Mondes de H. G. Wells n'est pas seulement un classique
de la littérature, mais LE modèle de référence
de toutes les histoires d'envahisseurs extraterrestres. La perspective
de voir notre planète tomber aux mains d'une superpuissance
qui réduirait à néant nos capacités de
défense, a de quoi terrifier. Le récit de Wells, dont la
première édition date de 1898, a gardé toute sa force,
au point que Spielberg le juge encore plus pertinent aujourd'hui
Steven Spielberg : «J'ai pensé que c'était le moment
de donner un grand coup d'avertisseur avec ce film». Le réalisateur,
qui s'était plu jadis à dépeindre des extra-terrestres
câlins et hospitaliers, était désireux de revisiter
le genre... au prix d'un virage à 180°. Inutile donc de chercher
ici les aliens aux longs doigts effilés et aux yeux rêveurs
d'E. T. ou RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE...
Tom Cruise : «Imaginez une version radicalement noire d'E. T. Personne
n'aurait envie de croiser de tels extra-terrestres»
Cruise interprète Ray Ferrier, un homme ordinaire, faillible et
imparfait, contraint d'assumer pour la première fois son rôle
de père face à la plus terrifiante des invasions.
Tom Cruise : «La question est simple : sa famille et lui vont-ils
s'en tirer? Survivront-ils? Ou encore jusqu'où êtes-vous
prêt à aller pour protéger
vos enfants?»
LA GUERRE DES MONDES est la deuxième collaboration de Spielberg
et Cruise après MINORITY REPORT.
Steven Spielberg : «Nous nous connaissions déjà depuis
de longues années, mais cela a créé entre nous une
nouvelle relation. Tom est un associé créatif, d'une rare
intelligence, qui vous apporte des idées formidables. Le courant
passe admirablement entre nous. J'adore travailler avec lui»
Collaboratrice de longue date de Spielberg, la productrice Kathleen
Kennedy note que LA GUERRE DES MONDES donne à celui-ci l'occasion
d'explorer l'autre face d'E. T. et RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE.
Kathleen Kennedy : «Lorsque nous avons commencé à
développer E. T., l'histoire était beaucoup plus dramatique,
beaucoup plus sombre. Je pense qu'il en resta des traces en Steven, et
aujourd'hui, c'est CETTE histoire qu'il a voulu raconter.»
Rick Carter (chef décorateur) : «Il y a vingt ans, ces extra-terrestres
étaient des créatures bénignes. Nos peurs à
leur égard se révélaient infondées. L'enfant
qui est en nous le comprenait intuitivement. Aujourd'hui, pour l'homme
qu'est Steven, et à l'époque qui est la nôtre, ces
créatures ne pouvaient que prendre une autre forme»
Steven Spielberg : «J'ai pensé que ce serait amusant de vous
faire trembler avec des extra-terrestres réellement terrifiants.
LA GUERRE DES MONDES est une histoire de survie qui se déroule
dans notre monde, bien loin du Pentagone et du Bureau Ovale, l'aventure
toute simple d'un père qui lutte pour la sauvegarde de ses enfants.
Une dimension ordinaire et basique de la nature humaine trouve ainsi à
s'exprimer dans un contexte extraordinaire et exceptionnel»
Cruise observe que Spielberg lui a décrit, dès le départ,
le film en termes subjectifs.
Tom Cruise : «On comprend que le monde entier est assailli, mais
tout est ramené au point de vue de Ferrier. Steven est un grand
observateur du comportement humain, dont les films fourmillent de
détails uniques et révélateurs. On retrouve une fois
encore cette qualité, cette capacité à mettre le
spectateur dans la peau des personnages, à les entraîner
au cceur de leur histoire et de leurs émotions.»
Steven Spielberg : «J'ai voulu que Ray soit cet homme ordinaire
capable d'incarner chacun de nous. Sa famille et lui représentent
nos propres craintes, notre propre capacité de survie et nos propres
ressources.»
A l'instar de H. G. Wells, Spielberg tenait à inscrire cette histoire
dans notre monde et notre présent.
Kathleen Kennedy : «Même si l'intrigue relève de la
pure fiction, son traitement est on ne peut plus réaliste. Steven
y explore, une fois encore, l'extraordinaire à partir d'un arrière-fond
ordinaire.»
Une approche typiquement Wellsienne, que le coscénariste David
Koepp et Josh Friedman furent chargés de mettre en oeuvre en racontant
cette aventure épique à l'échelle d'une famille.
Kathleen Kennedy : «Le scénario adhère brillamment
à la notion de «point de vue personnel» qu'exploitait
déjà Wells. Ray et les siens sont affectés dans leur
chair par cet événement d'ampleur planétaire.»
Koepp, qui aida Spielberg à faire entrer les dinosaures du jurassique
dans notre imaginaire contemporain, ne voyait pas d'autre option que de
préserver la simplicité foncière de cette histoire.
David Koepp : «L'invasion de notre Terre serait un sujet tellement
immense que nous ne pourrions même pas envisager de le traiter»
Cette réflexion amena les scénaristes à se concentrer
sur une seule famille : «Plus vous vous focalisez sur ces trois
personnages et leur dilemme - leur isolement, l'absence d'informations
-, plus cela devient dramatique et personnel.»
Tom Cruise : «Steven et moi voyons en LA GUERRE DES MONDES «le
plus grand de nos petits films»! Certes, c'est une épopée
- la plus vaste à laquelle j'aie jamais participé -, mais
c'est aussi l'histoire intimiste d'une famille. Steven, David et moi avons
souhaité la dédier à nos enfants et y exprimer tout
l'amour que nous leur portons. Je pense que ce film illustre ce que des
parents sont prêts à faire pour leurs enfants.»
Le roman de Wells a eu un impact si durable sur notre culture qu'on peine
à mesurer la radicale nouveauté de ses thèmes.
La Guerre des Mondes a, en effet, posé les fondations d'un genre
qui a fleuri à travers une multitude de moyens d'expression
littérature, radio, cinéma, télévision...
«Ce livre est périodiquement réédité,
chaque fois que renaît la peur d'une invasion», observe le
Dr. Martin Wells, zoologue, auteur et petit-fils du romancier. «Les
Anglais avaient une peur bleue du Kaiser à l'époque de sa
parution, et il y a toujours eu une correspondance entre l'état
du monde et les diverses périodes où ce livre revient sur
le devant de la scène.»
Tom Cruise : «Lorsque j'ai lu le roman, j'ai été frappé
par la puissance d'imagination qu'il a fallu à Wells pour élaborer
un scénario crédible et nous le donner à vivre comme
une aventureréelle et actuelle.»
Spielberg souhaitait préserver cette qualité intrinsèque
du texte original, tout en évitant certains des clichés
que le livre a engendrés.
David Koepp : «Nous avons dressé la liste des choses dont
nous ne voulions à aucun prix : des destructions de monuments
historiques, des scènes dans Manhattan ravagé, des
brochettes de généraux et d'amiraux dissertant autour d'une
grande carte, des équipes de télé filmant la catastrophe..»
Steven Spielberg : «Et surtout PAS DE MARTIENS! Nous sommes allés
sur Mars, et nous savons qu'il n'y a personne là-bas.»
David Koepp : «Oue reste-t-il? Tout simplement, le cceur du livre
: le récit à la première personne d'une attaque d'extra-terrestres.»
Après le succès de leur collaboration sur MINORITY REPORT,
Spielberg et Tom Cruise s'étaient tout de suite entendus pour
renouveler l'expérience.
Tom Cruise : «C'est un rêve pour moi que d'être en mesure
de travailler avec Steven Spielberg. Ses films ont accompagné ma
jeunesse, ils ont été pour moi un sujet d'étude,
et je taquine volontiers Steven en lui disant que je les connais mieux
que lui. Ils sont une vraie leçon de cinéma - on y découvre
du nouveau à chaque vision.»
L'occasion surgit lors d'une visite de Cruise sur le plateau d'ARRÊTE-MOI
SI TU PEUX.
Tom Cruise : «Steven mentionna trois titres, dont le dernier était
LA GUERRE DES MONDES. Nous nous sommes regardé un bref instant,
et ce fut comme une révélation. LA GUERRE DES MONDES? Bien
sûr! Tout était dit»
Superstar internationale, Tom Cruise confère au personnage de Ray
Ferrier la vitalité et la complexité qui sont la marque
de son talent.
Steven Spielberg : «Il dynamise chaque scène par sa prodigieuse
énergie et sa présence, et donne au personnage un fabuleux
élan.»
L'enthousiasme et l'énergie de Cruise se communiquèrent
à l'ensemble du plateau, comme en témoigne son partenaire
Tim Robbins.
Tim Robbins : «On ne s'est jamais relâchés. Tom est
un pro, un acteur d'une immense générosité. Même
lorsqu'il vous donne la réplique horschamp, il reste complètement
dans la peau du personnage et s'y investit à 100%.»
Ray Ferrier se démarque à la fois des personnages nobles
et des anti-héros du DERNIER SAMOURAÏ et COLLATÉRAL.
Steven Spielberg : «Sitôt que nous avons commencé à
travailler sur le projet, j'ai expliqué à Tom «J'ai
envie que Ray soit tout le contraire d'un héros. C'est quelqu'un
qui fuit et auquel se pose soudain le problème de défendre
sa famille, d'assurer la sécurité de ses enfants. Tom était
partant. Il trouvait très excitant que sa seule guerre dans ce
film soit une guerre privée»
David Koepp : «Au début du film, Ray est un père désarmé.
Ce rôle ne l'intéresse pas, il ne le «sent» pas.
À juste titre : il y est nul. Ses enfants ne le lui cachent pas,
ils n'ont guère d'affection pour lui et rechignent à l'idée
de lui rendre une simple visite.»
Tom Cruise : «Il ne comprend pas ses enfants, il se comprend
à peine lui-même. Lorsque les choses vont mal, il se tourne
vers eux pour trouver la solution. Il est bien plus infantile qu'eux»
Kathleen Kennedy : «Ray n'a jamais assumé sa paternité,
il s'est refusé à grandir. Et c'est ce voyage qu'il s'apprête
à accomplir: il doit réaliser que la chose la plus importante
qu'il ait à faire est de s'impliquer dans la vie de ces deux enfants.»
Le parcours émotionnel de Ray avec ses enfants constitue le pivot
de cette histoire aux marges de laquelle se joue la destruction de
notre planète.
Kathleen Kennedy : «C'est en quoi LA GUERRE DES MONDES diffère
de tant de films de genre. Il repose avant tout sur des rapports humains,
il traite spécifiquement de la dynamique d'une famille et de sa
survie»
Avant même le début du film, un gouffre s'est creusé entre ce «père inepte» et ses enfants, la petite Rachel (Dakota Fanning) et l'adolescent Robbie (Justin Chatwin), venus sans enthousiasme lui une courte (et rare) visite. Mais c'est un défi bien plus important qui attend Ray. À peine son ex-femme et le nouveau mari de celle-ci repartis, le voici confronté à l'épreuve majeure qui, selon Spielberg, définit un bon père : «protéger à tout prix les êtres qui vous sont chers».
La seule mesure qui s'impose lorsque se déclenche l'attaque des
Tripodes est de tenter de rester en vie.
Dennis Muren (superviseur senior des effets visuels) : «Toutes nos
belles théories, tout notre arsenal sont impuissants face à
cet ennemi. Rien n'arrêtera l'invasion. Votre pire cauchemar
est en train de se réaliser - à l'échelle de tout
un pays»
Le monde s'effondre littéralement autour de Ray, Rachel et Robbie.
Les tensions familiales redoublent, et en l'espace de quelques minutes,
un homme va devoir devenir le père qu'il n'a jamais su être
- ou mourir avec ses enfants.
Rachel est interprétée par la jeune prodige Dakota
Fanning, 11 ans, vedette de la mini-série DISPARITION, «présentée
par Steven Spielberg» et de la comédie DreamWorks LE
CHAT CHAPEAUTÉ.
Steven Spielberg : «J'ai pensé à elle dès la
première minute. Je ne connais aucune enfant de cet âge qui
soit plus douée, plus lucide au sujet de la nature humaine. On
a l'impression qu'elle a déjà vécu cinq ou six vies.
Sa maturité l'a servie dans ce rôle où elle doit parfois
se montrer plus futée que son père.»
Tim Robbins : «Dès notre première scène, je
me suis dit "Cette fille a 35 ans!", tant elle était
concentrée et émotionnellement impliquée. On
est stupéfait de découvrir une telle maturité chez
une enfant.»
Travailler avec Spielberg et Cruise fut un vrai rêve pour la jeune
comédienne qui a déjà fait la preuve de ses dons
face à des monstres sacrés comme Sean Penn, Robert De Niro
et Denzel Washington.
Dakota Fanning : «Je suis tellement heureuse d'avoir pu travailler
avec Steven et avec Tom, qui par leur gentillesse vous rend tout agréable
et amusant. J'ai tant appris avec eux! »
Après avoir longtemps cherché un garçon qui
pourrait incarner le fils de Tom Spielberg choisit un nouveau venu : Justin
Chatwin.
Kathleen Kennedy : «Justin avait fait des débuts phénoménaux
dans CHUMSCRUBBER, et il est ici hautement convaincant dans le rôle
de cet ado de dix-sept ans en conflit avec son père.»
Robbie est à cet âge «difficile» où les
jeunes aspirent contradictoirement à être reconnus et indépendants
- un facteur qui complique encore sa relation avec Ray.
Steven Spielberg : «Robbie est le porte-parole d'une génération
entière de jeunes qui rejettent systématiquement le
discours de leurs parents... et même leurs goûts vestimentaires.»
Les frictions entre Ray et Robbie n'empêchèrent pas Chatwin
de trouver en son «père» de fiction un soutien fidèle
et attentionné.
Justin Chatwin : «Tom a toujours été disponible en
tant qu'acteur, et c'est merveilleux de pouvoir travailler ainsi
avec une aussi grande star.»
Une solide complicité frère/sœur s'est nouée
entre Robbie et Rachel, qui pallie les carences de leur père
et leur permet de mieux supporter la séparation de leurs parents
et la recomposition de leur famille.
Justin Chatwin : «C'est l'histoire très contemporaine d'une
famille éclatée. Le père et le fils n'arrivent plus
à se parler, la fille a rompu le dialogue avec le père.
Résultat : le frère et la saur doivent compter l'un sur
l'autre et se bâtir leur propre monde.»
Durant le tournage, ce lien privilégié favorisa le
rapprochement des deux interprètes.
Dakota Fanning : «Justin est maintenant un frère pour moi,
car nous avons été si longtemps ensemble, à New York,
en Californie, en Virginie...
Justin Chatwin : «Dakota est un vrai phénomène. je
ne sais pas d'où lui viennent ses dons, mais elle m'en a appris
chaque jour»
L'actrice australienne Miranda Otto était de passage à
Los Angeles lorsque son agent l'informa que Steven Spielberg souhaitait
ta rencontrer. Eceinte, elle craignait de devoir refuser son offre, mais
découvrit que cette grossesse (amplifiée à l'écran)
serait un atout supplémentaire, un élément propre
à étoffer - et compliquer encore un peu plus - les relations
entre Ray et son ex-femme, Mary Ann. Bien que désuni, ce couple
a réussi à préserver une part de son passé.
Kathleen Kennedy : «Ils sont loin de se détester, et sont
très attachés à leurs enfants. C'est leur relation
de couple qui a tourné au fiasco.»
«Il n'y a aucune animosité entre eux», complète
Spielberg, qui invoque un mariage trop précoce et une insurmontable
différence de statut entre Ray et Mary Ann.
Kathleen Kennedy : «Lui, est un col-bleu, un docker qui est resté
fondamentalement un gamin. Elle, issue d'une riche famille du Connecticut,
a vécu dans un grand ranch et a possédé des chevaux
dès son plus jeune âge. Elle l'a trouvé sexy - c'est
Tom Cruise après tout! - ils sont tombés amoureux, se sont
mariés très jeunes, ont eu deux enfants. Mais ils n'ont
jamais réussi à combler leur «fracture sociale»
et à harmoniser leurs points de vue. J'ai pensé que cela
ferait un contraste fort»
David Koepp : «Ray est si peu sûr de lui que son premier réflexe
est de ramener les enfants à leur mère, sachant qu'elle
saura s'en occuper»
Spielberg et Cruise sont tous deux fans du film LA GUERRE DES MONDES,
produit en 1953 par George Pal et réalisé par Byron
Haskin. Le réalisateur a demandé aux deux stars de ce film,
Gene Barry - qu'il avait dirigé à ses débuts dans
«Les Règles du feu» - et Ann Robinson, de faire une
petite apparition dans sa propre adaptation.
Gene Barry : «Je suis très honoré qu'il m'ait demandé
de participer à son film. C'est un grand moment pour moi, doublé
de l'émouvant rappel d'un film qui compta beaucoup dans ma
carrière.»
Ann Robinson : «Faire son retour à l'écran avec le
plus grand réalisateur du monde et l'acteur le plus populaire de
la planète... est un vrai bonheur»
Steven Spielberg : «Je tenais beaucoup à leur participation.
J'étais un grand admirateur de Gene à l'époque
où je travaillais sur sa série. Je pense que c'était
ma deuxième ou troisième télé, et cet épisode
futuriste des «Règles du Jeu» tranchait nettement sur
les autres. Gene a été sincèrement surpris par ma
demande et il a été, comme Ann, ravi d'y répondre
dans cette scène qui constitue l'un de nos nombreux hommages au
film original.»
L'invasion atteint un stade critique lorsque Ray et sa fille, répondant
à l'invitation d'un inconnu, gagnent le sous-sol d'une veille
ferme. Mais l'angoisse monte encore d'un cran, car tous deux réalisent
que les extra-terrestres ne sont pas le seul danger qui les guette...
L'inquiétant «sauveur» que joue Tim Robbins, est un
homme brisé du nom d' O gilvy.
Steven Spielberg : «Il a perdu toute sa famille, comme des millions
de gens, et s'est réfugié dans la cave de cette ferme. Il
a un plan, mais un plan dément. Son état de confusion est
excusable, du fait de la perte tragique qu'il a subie, mais cet homme
n'en représente pas moins un vrai danger pour la fillette et son
père.»
Tim Robbins : «Au beau milieu de ce film d'action et d'aventures
émergent soudain un drame psychologique intense et un nouveau
péril. Un développement motivé par des événements
précis, et qui n'a rien de gratuit»
Kathleen Kennedy : «Je pense qu'il a fallu un grand courage à
Steven pour introduire cette confrontation dramatique. C'était
un choix audacieux dans un tel contexte, et qui singularise encore un
peu plus le film au sein du genre.
Tim s'est très tôt imposé à nous. Ses talents
d'acteur lui permettraient de «tenir l'écran» en dépit
de la relative brièveté du rôle, de l'espace très
restreint où il aurait à évoluer et de l'ampleur
du reste du film.»
Steven Spielberg : «Ogilvy est l'une de nos références
au livre de Wells. Il fait penser au personnage du Vicaire, avec lequel
le protagoniste est obligé de partager un espace ultra-confiné.
C'est un épisode particulièrement inconfortable du roman,
et j'ai tenu à produire cette même sensation chez le spectateur»
Passant d'un espace urbain et d'un réseau d'autoroutes à
de vastes paysages envahis par des flots de réfugiés, nous
échouons dans cette cave obscure, coupée du monde.
Rick Carter : «Nos personnages ont traversé ces espaces nus
et ont cherché leur salut par les moyens les plus simples - en
suivant une route, en longeant une rivière. Et voilà qu'ils
débarquent dans ce lieu d'un autre temps, dans cette ferme isolée
au sommet d'une colline. De l'autre côté, la guerre fait
rage. Ils croient avoir enfin trouvé un refuge, mais ce qui les
attend là est encore pire que tout ce qui a précédé...»
Steven Spielberg : «C'est une odyssée, un voyage instinctif
qui débute dans le New jersey et s'achève à Boston.
Il ne couvre qu'une toute petite distance si on le compare à
celui des envahisseurs, et pourtant, c'est toute une vie qui s'y joue..»
Pré-production. L'équipe se (re)forme.
La production de LA GUERRE DES MONDES se monte «à très
vive allure», sitôt que Tom Cruise et Steven Spielberg ont
fixé leur choix sur ce projet.
Kathleen Kennedy : «Steven m'a déclaré : «OK,
nous allons faire ce film et nous avons besoin de démarrer dans
trois mois. Mais ne panique pas à la lecture du script. Sache qu'il
n'y a en réalité que trois personnages... et mille autres
en train de courir au fond du champ!»
Deux équipes se mirent très vite en place, à l'automne
2005 sur les côtes Est et Ouest, la première effectuant des
repérages en vue d'un proche démarrage et la seconde
préparant les plateaux et décors californiens qui seraient
utilisés après les vacances de fin d'année.
Kathleen Kennedy : «Dès cette époque, le bureau de
production de la côte Est était en pleine activité,
et une bonne partie du personnel technique rassemblé, tandis
que l'équipe de la côte Ouest préparait la deuxième
phase du tournage.»
Les délais de préparation avaient été raccourcis
de moitié par rapport aux normes d'un film de cette ampleur.
Spielberg observe cependant : «Nous n'avons jamais forcé
l'allure, nous avons pris le temps nécessaire. Ce fut même
mon tournage le plus long depuis douze ans.»
Janusz Kaminski (Directeur de la photographie) : «Ce n'est pas un
hasard si nous avons pu travailler à ce rythme. La première
raison, c'est que notre réalisateur est en pleine possession
de ses moyens et qu'il connaît très bien le genre.»
L'équipe s'accorde unanimement à reconnaître qu'il
existe peu de réalisateurs assez inventifs et expérimentés
pour monter aussi rapidement un projet de cette ampleur.
Joanna Johnston (Chef costumière) : «C'est terrifiant mais
incroyablement stimulant de travailler dans de telles conditions.
Je ne connais personne qui égale Steven sur ce terrain. Il sait
exactement ce qu'il veut»
La précision du cinéaste, sa détermination,
sa facilité à communiquer avec une équipe hyper-efficace,
qu'il connaît intimement, garantissaient la bonne marche du
projet.
Kathleen Kennedy : «La majorité des principaux chefs de service,
dont moi-même, travaillent régulièrement avec Steven
depuis quinze ou vingt ans.»
Plusieurs de ceux-ci ont inscrit leur nom aux génériques
de multiples projets Spielberg : Kathleen Kennedy (15 films), le producteur
Colin Wilson (10 films), le directeur de la photographie Janusz Kaminski
(9 films), le chef décorateur Rick Carter (6 films), le chef monteur
Michael Kahn (19 films), le compositeur John Williams (21 films), le superviseur
senior des effets visuels Dennis Muren (10 films), la chef costumière
Joanna Johnston (4 films), le chef cascadeur Vie Armstrong (5 films),
la décoratrice de plateau Ann Kuljian (3 films), le chef accessoiriste
Doug Harlocker (2 films) et l'ingénieur du son Ron Judkins (11
films).
«Quantité de postes-clés sont tenus par des gens qui
se connaissent si bien qu'ils ont élaboré un mode de communication
ultrarapide», souligne le vétéran Colin Wilson,
qui débuta auprès de Spielberg comme monteur.
Les premières étapes de la préproduction illustrèrent une fois de plus les dons de stratège de Spielberg et son exceptionnelle aisance à se mouvoir du monde des prises de vues «réelles» à celui des effets visuels, et vice versa.
Le plan de tournage donnait en effet à Dennis Muren, Pablo Herman
et leur équipe d'Industrial Light & Magie le maximum de temps
pour bâtir les séquences à effets visuels.
Kathleen Kennedy : «Nous savions qu'il y aurait un bon nombre
de ces effets et que la post production serait relativement brève.
Nous étions conscients qu'il faudrait tourner en premier lieu les
séquences à grand spectacle qui demanderaient le plus
d'effets visuels, de manière à ce qu'ILM puisse se mettre
très vite à l'ouvrage. Lorsque nous nous sommes rendus sur
la côte Est, c'est donc par la séquence de l'intersection
que nous avons démarré, car elle comportait une énorme
figuration et quantité d'effets.» Rick Carter se souvient
d'un coup de f de Spielberg durant cette période.
Rick Carter : «J'ai tout de suite sauté dans un avic et me
suis retrouvé dans le New jersey. premier jour des repérages,
je me suis renc dans les environs de Newark, où j'ai trou une intersection
de cinq routes constituant i décor idéal pour la première
rencontre avec 1 extra-terrestres.»
L'univers de la guerre des mondes
C'est dans ce site que l'équipe technique, les comédiens
et quelques centaines de figurants filmeraient la première confrontation
de Ray avec un «Tripode».
Spielberg s'était fait par avance une idée extrêmement
précise des lieux et de plusieurs autres décors-clés
du film. Il avait en effet commencé à y travailler «virtuellement»
depuis le début de la préproduction, par le biais d'animation
en 3D-équivalents numériques et animés de story-boards
qui ne «pré-visualisent» pas seulement l'univers
général de la scène mais chacune de ses composantes
futures : décor, personnages, position des caméras, etc.
Steven Spielberg : «J'avais déjà utilisé ce
procédé, mais c'est la première fois que je l'emploie
pour animer la totalité des story-boards.»
C'est une visite à son ami George Lucas qui persuada le réalisateur
de tirer profit de cette technique et de «recruter la plupart des
experts qui avaient contribué aux trois derniers STAR WARS».
Kathleen Kennedy : «C'est un formidable outil de communication.
En août, nous avions fini nos repérages. Nous avons alors
numérisé l'ensemble de ce matériau visuel et avons
bâti nos séquences à partir des décors naturels.
Steven a élu domicile dans le bureau où les gars fabriquaient
cela dans leurs ordinateurs. L'aboutissement de ce travail préfigurait
avec une remarquable précision ce qu'il a tourné par la
suite.»
Le superviseur «Previz» Dan Gregoire, qui fut l'un des chefs
de l'équipe Animatiques des deux derniers STAR WARS, détaille
son approche.
Dan Gregoire : «Au départ, c'est un paragraphe, voire une
ligne de texte, du genre : «Newark, ext. jour - Un Tripode jaillit
des profondeurs de la terre». Steven sait très exactement
ce qu'il veut en tirer, mais il reste à l'expliquer à tous
ceux qui l'entourent, du directeur photo aux machinistes en passant
par le chef électricien. C'est là que nous intervenons avec
nos ordinateurs nous fabriquons cette intersection en 3d, nous abriquons
le Tripode, nous fendons la terre en images de synthèse, et nous
faisons tout sauter. En bref, nous développons cette séquence
à partir de zéro, de manière à pouvoir la
montrer sur le plateau, à Newark, et que chacun comprenne
bien les intentions de Steven.»
La pré-visualisation permit aussi aux acteurs de se faire une image
mentale précise des créatures virtuelles qui seraient,
en plateau, leurs partenaires fantômes.
Steven Spielberg : «Je les ai amenés devant l'ordinateur
pour leur montrer les maquettes des séquences. Ils purent ainsi
connaître la taille exacte des gigantesques Tripodes et leurs positions
respectives. J'aurais aimé disposer d'un tel outil sur RENCONTRES
DU TROISIÈME TYPE.
A l'époque, nos comédiens avaient dû déployer
des trésors d'imagination, car j n'avais pas encore conçu
certains des vaisseaux spatiaux. J'en étais réduit à
leur lancer «Regarde la grosse tarte qui traverse le ciel vois comme
elle est grande!» Alors qu'ici, les acteurs disposaient d'une référence
visuel et pouvaient se faire une idée concrète à
résultat. Ce que tout un chacun a trouvé stimulant.»
Rick Carter : «Après des semaines de travail sur ordinateur,
lorsque nous nous sommes retrouvés pot de bon face à cette
intersection, j'ai demandé à Steven : «Laquelle préfères-tu?
La vraie ou la virtuelle?». Il a commencé par me dire «
virtuelle», puis «non, la vraie», et finalement «je
les aime toutes les deux.»
En dépit des pluies torrentielles, des centaines de curieux et
de paparazzi, le tournage de la séquence se déroula sans
le moindre accroc.
Tom Cruise : «Nous avons bouclé l'épisode en seulement
six jours, sans avoir l'impression de font indûment ou d'improviser.
Nous étions très concentrés, nous savions exactement
ce qui était au programme de la journée. La pré-visualisation
nous a permis de tout anticiper»
Des extérieurs aux décors, des costumes aux accessoires prévalut un même mot d'ordre : réalisme. Le film s'inscrit dans un monde qui reflète notre propre quotidien, son style évoluant graduellement au fil de l'invasion.
La chef costumière Joanna Johnston créa 60 versions différentes du blouson de cuir de Ray, marquant sa dégradation inexorable au cours du voyage, «jusqu'à ce que Tom n'ait plus sur lui qu'un t-shirt et un jean, dans la plus pure tradition des héros d'antan.»
Rachel, qui apparaît d'abord dans des tenues très «girly», subit le même traitement, ses vêtements roses s'encrassant et s'usant rapidement au fil de l'aventure. «J'ai quand même voulu que Dakota ait en permanence avec elle un objet rassurant - en l'occurrence un capuchon couleur lavande qu'elle enfile pour dormir en paix.»
La chef costumière souligne à sa façon les similitudes
cachées entre Robbie et son père.
Joanna Johnston : «Ils se ressemblent plus qu'ils n'imaginent, et
Robbie imite inconsciemment le style de Ray, avec ses jeans, sa capuche
à l'effigie d'une grande équipe de base-ball... rivale de
celle de son père, bien sûr.»
Joanna Johnston eut l'occasion de s'entretenir avec Ann Robinson
sur le tournage de la version 1953.
Joanna Johnston : «En nous voyant fabriquer nos milliers de costumes,
Ann m'expliqua à quel point les conditions avaient changé.
À l'époque, elle avait dû se rendre elle-même
dans une grande surface et y faire acheter par une assistante les DEUX
costumes qui lui serviraient pour toute la durée des prises de
vues!»
Spielberg fait à nouveau appel aux talents de Janusz Kaminski,
chef opérateur de ses 9 derniers films, qui a opté avec
lui pour un ample usage de la caméra portée, à des
fins de réalisme et d'efficacité dramatique.
Steven Spielberg : «Janusz savait que j'étais en quête
de réalité. Il ne s'agissait pas de décrire
les événements «à vol d'oiseau»,
mais de capter les points de vue personnels d'un homme et de deux enfants.
Une raison de plus pour adopter un style et des éclairages naturels.»
Tom Cruise : «LA GUERRE DES MONDES est le troisième
film que je fais avec Janusz et son équipe (après JERRY
MAGUIRE et MINORITY REPORT). Janusz est un sacré personnage, doublé
d'un authentique artiste. Il a réussi à satisfaire à
la fois aux exigences stylistiques de Steven et à celles des effets
visuels.»
Janusz Kaminski : «J'ai fait ici un tout autre travail que sur nos
films précédents. Steven a une approche poétique
et sophistiquée du visuel. Le film possède une belle palette,
qui évolue d'une dominante bleutée à une gamme de
plus en plus riche et intense. C'est stylisé, mais dans les limites
du réalisme. Et les éclairages sont vraiment intéressants.»
Le réalisateur et son chef opérateur ont usé d'une
grande diversité de moyens, de sources, de contrastes et d'effets
pour inscrire ces événements fantastiques dans un environnement
réel et leur conférer un maximum de crédibilité.
Doug Harlocker (Chef accessoiriste) : «Ainsi, dans la scène
où Ray et ses enfants se heurtent au flux croissant des errants,
Janusz et Steven ont demandé une grande quantité d'interactions
lumineuses. Nous avons donc fourni aux figurants des accessoires
de toutes sortes, de la lampe de poche au flash et à la bonne vieille
lampe à huile, ce qui enrichit la texture visuelle de la scène
et en renforce la frénésie chaotique.»
Le chef opérateur dut également assurer la continuité
visuelle des intérieurs studio et des extérieurs, jonglant
à l'occasion entre trois environnements distincts.
Janusz Kaminski : «Il y a une scène très intéressante
à ce point de vue, où nos trois personnages marchent
le long d'une route en direction d'une grande colline. Des troupes arrivent,
puis des milliers de fuyards affluent, qui se dirigent eux aussi vers
les hauteurs. Nous avons tourné la première partie un soir,
en Virginie, la seconde en studio, et la troisième en Californie
du Sud. Trois environnements, trois conditions météo, trois
problèmes d'éclairage distincts...»
Rick Carter souligne la capacité - si rare - de Spielberg à
mêler intimement réel et fantastique.
Rick Carter : «Je n'ai jamais réussi à deviner en
première vision comment il arrivait à un tel mariage.
En fait, il le prémédite dès le départ, non
dans le but de vous épater par son brio, mais tout simplement parce
que c'est ainsi qu'il perçoit les choses.»
Aucune des séquences à grand spectacle de LA GUERRE
DES MONDES n'aurait pu exister sans un recours systématique aux
effets visuels.
Steven Spielberg : «Dennis Muren fut donc l'un des premiers
noms à s'inscrire sur ma liste.»
Lauréat de 8 Oscars des meilleurs effets visuels (dont trois pour
E. T., INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT et JURASSIC PARK), Muren n'a
cessé de jouer un rôle moteur dans le développement
de l'art des effets visuels.
Rick Carter : «Dennis et les gens d'ILM nous apportent eur capacité
à percevoir des choses invisibles .u commun des mortels. Ils nous
permettent e les fixer sur pellicule comme si elles avaient ou jours fait
partie du monde sensible. » Dennis Muren : «Je suis perpétuellement
en quête de renouveau. Sitôt que je finis un tournage, je
me dis. «Ce film est déjà obsolète, ses effets
visuels sont dépassés, que puis-je faire de neuf?»
Faire LA GUERRE DES MONDES était une idée excitante, notamment
parce qu'elle nous donnait l'occasion de revisiter le livre et ses machines
de guerre en essayant d'inventer un style intéressant aux Tripodes
et, accessoirement, aux extra-terrestres. On ne s'est pas contenté
de dire «banco» au premier dessin, ni au deuxième,
ni au dixième, ni au
quinzième.»
Plutôt que de s'appuyer majoritairement sur l'infographie,
Muren a tenté avec Spielberg de définir la technique la
plus appropriée à chaque plan.
Dennis Muren : «Ayant vécu la grande époque des modèles
réduits, je n'ai aucune réticence à dire «Faisons
ceci sous forme de maquette, et cela en ordinateur», puisqu'il s'agit
toujours de servir au mieux la scène. Nous avons chez nous quantité
de maquettistes et modélistes talentueux que nous savons faire
travailler ensemble. Il est important d'utiliser chaque outil de la boîte
à outil, et pas seulement l'infographie.»
Spielberg, Muren et Kaminski ouvrèrent de concert pour assurer
la parfaite synchronisation de ces éléments disparates.
Steven Spielberg : «J'ai l'habitude de travailler ainsi depuis RENCONTRES
DU TROISIÈME TYPE, de mixer ces ingrédients comme pour une
salade mélangée. Il faut traiter chacun séparément,
mais avec le même soin, le même amour, avant de les mêler
dans le grand saladier. Et lorsque tout est bien dosé, bien assaisonné,
c'est un pur régal.»
Le plan de travail n'autorisant pas une longue postproduction, celle-ci
débuta dès le tournage des extérieurs, par d'incessants
allers-retours de vidéos entre le QG de la production et les ateliers
d'ILM.
Dennis Muren : «Cela a énormément accéléré
le processus, grâce à un contact permanent avec Steven
qui nous a fait gagner plusieurs semaines.»
Pablo Herman (superviseur des effets visuels) : «Avant Steven, je
n'avais jamais vu un réalisateur nous livrer son travail dans les
délais. Cette fois, tout le boulot sur les effets visuels s'est
achevé en même temps que les prises de vues. C'est une
première pour moi.
La pré-visualisation fut également un apport important
dans le développement des redoutables Tripodes.
Steven Spielberg : «Nous avons entrepris une recherche collective
tous azimuts sur le dessin des Tripodes et de leur univers. Il était
important d'explorer cela en 3D et en couleurs et non plus en 2D,
comme je l'avais fait ces trente dernières années.»
Spielberg réunit une équipe de haut vol pour cette création
globale, avec à sa tête : Rick Carter, Dennis Muren, le designer
concepts Doug Chiang, Ryan Chruch d'ILM et Dan Gregoire.
Steven Spielberg : «J'avais sous la main une incroyable brochette
d'artistes, travaillant plus ou moins en collaboration, lançant
des idées, improvisant des concepts - certains sublimes, d'autres
ridicules. Nous avons élaboré de la sorte une vingtaine
ou une trentaine de dessins d'extraterrestres dont certains réintégraient
tel ou tel détail qui m'avait plu dans une esquisse antérieure.»
Dennis Muren : «Au départ, vous réunissez une grande
quantité d'artistes en les incitant à faire travailler leur
imagination. Ensuite, vous les guidez de très près... et
le moins possible. Car il s'agit à la fois que le processus conserve
gamme ouverte d'idées, mais aussi que ces idées collent
avec les besoins de l'histoire.
Steven sait exactement ce qu'il veut. Il suffit en réalité de lui présenter les bons éléments. Vous faites donc une série de collages de toutes les propositions valides. Il retiendra alors un élément du premier, un détail du second, etc., et lorsque vous aurez fait la synthèse de tout ce qui lui convient, vous êtes quasiment assuré d'un accord enthousiaste et immédiat. C'est très facile de travailler avec lui parce qu'il a les idées claires. Les prises de décisions ne sauraient être plus aisées.»
Spielberg se remémorant les saisissantes descriptions des
Tripodes dans le roman de Wells, souhaitait qu'ils inspirent la même
peur, rien que par leur apparence physique.
Doug Chiang : «Les Tripodes sont l'image de la terreur et, du fait
que les ressorts de cette émotion diffèrent en chacun de
nous, ces machines sont l'expression de ce qui m'effraie le plus, de ce
qui terrifie le plus Rick Carter et, nous l'espérons, de ce
qui VOUS fait le plus peur.
En outre, ce n'est pas seulement par leur forme que les Tripodes vous impressionneront, mais par la façon dont ils ont été filmés et dont votre imagination sera sollicitée. Ce que vous en êtes réduit à deviner, ce que vous ne voyez PAS, est toujours ce qui vous fait le plus peur..»
L'animation des Tripodes a été supervisée par
Randy M. Dutra, d'ILM, colla PERDU, qui s'est attaché à
leur attribuer une gestuelle étrangère à notre univers,
quoique crédible au sein de celui-ci.
Randy M. Dutra : «Steven a tout de suite compris qu'il fallait
impérativement s'ancrer dans l'ORGANIQUE. Lui et moi avons
d'ailleurs le plus grand respect pour la nature. Mes animateurs le savent,
et c'est en elle qu'il vont chercher leurs références. De
sorte que, même lorsque le point de départ n'est plus reconnaissable,
ces racines naturelles perdurent. Je pense que ce sont ces éléments,
parfois infimes, qui font en définitive la crédibilité
et l'originalité d'un personnage imaginaire.»
Dennis Muren : «Ces Tripodes en marche sont faits pour inspirer
la peur, l'humilité face à un danger incommensurable. Ils
sont là, ils ont pris le contrôle de la situation, vous n'y
pouvez rien. Mais cela ne fonctionne que parce que Tom et ses partenaires
ont su réagir à nos créations. Le film repose sur
leurs épaules. Il est avant tout l'histoire d'un homme et de sa
relation avec ses enfants»
"Coast to Coast" les extérieurs
De Newark et Bayonne à Brooklyn, de Naugatuck (Connecticut) à
Athens (État de New York), l'équipe a sillonné la
côte Est avant d'aboutir en Virginie orientale.
C'est à Lexington, modeste bourgade qui abrite l'Université
Washington and Lee'et l'Institut Militaire de Virginie, que s'achève
ce rapide périple, juste avant les congés de fin d'année.
Un vallon niché entreé les collines offrait un décor
de rêve pour, le première partie de la séquence dite
de la «Guerre de la Vallée».
Des centaines de fuyards déguenillés, poussant des carrioles bourrées d'objets héteroclites seraient les premières victimes cet affrontement, aux côtés d'un détachement de la Garde Nationale rapidement débordé. (La production avait obtenu ces derniers auprès de la 10ème Division de Montagne de l'Etat de New York, des Marines de Camp Pendleton, en Californie, et des régiments de Fort Irwin et Twentynine Paims, également en Californie.)
Après avoir regagné la côte ouest, l'équipe
a repris le travail dans la région de Los Angeles, notamment à
Piru où a été filmée la deuxième partie
de cette séquence, et à Mystery Mesa, à quelque 90
km au nord de L.A.
Une petite colline des Studios Universal a été, entièrement
aménagée et «habillée» pour le crash
dévastateur d'un 747.
Rick Carter : «Imaginez ce spectacle cauchemardesque un avion percutant
une colline habitée et répandant ses débris sur des
centaines de mètres carrés. Pour préparer cet immense
décor, il nous a d'abord fallu acheter un 747, puis le découper
en morceaux, étaler ceux-ci à la surface du terrain, et
enfin construire une série de maison. Un rude travail...»
Durant son passage aux Studios Universal, l'équipe utilisa aussi l'immense bassin sphérique du plateau 27 pour la portion subaquatique de la séquence du ferry.
Sur le plateau 16 de la Fox, Carter et son équipe reconstituèrent
le décor de la séquence surréaliste de la ferme,
dont des portions avaient été filmées antérieurement
en Virginie et à Mystery Mesa.
Rick Carter : «Cette fois, nous avons entièrement recouvert
le terrain d'une mauvaise herbe écarlate. Steven avait eu l'idée
d'un long mouvement d'appareil à travers un couloir sombre, avec
une transition soudaine du noir et blanc à la couleur lorsque s'ouvre
la porte de la ferme. L'effet rappelle LE MAGICIEN D'OZ,, lorsque
le Technicolor explose littéralement sur l'écran... sauf
qu'ici, le monde entier à viré au rouge.»
Kathleen Kennedy : «C'est la preuve que les envahisseurs ont pris
possession de notre planète et l'ont remodelée à
l'image de la leur. Et quand vous comprendrez pourquoi ils ont choisi
le rouge..»
L'équipe occupa, outre de nombreux décors naturels, six
plateaux répartis sur trois studios, et constituant chacun un monde
en soi.
Tim Robbins : «Steven Spielberg perpétue cette tradition
hollywoodienne qui consiste à travailler en studio, en adaptant
totalement le plateau à nos besoins et à notre imaginaire.»
Spielberg - qui est sans doute l'un des rares cinéastes contemporains
à employer une table de montage «à l'ancienne»
- marie ainsi dans l'exercice quotidien de son métier de multiples
techniques et traditions de l'art du cinéma, des plus anciennes
aux plus modernes.
Steven Spielberg : «J'ai besoin de quelque chose qui m'inspire,
qui m'aide à inventer le style d'un film.
Ce serait totalement futile d'essayer de fabriquer tout cela en post production. Je crois que je vais donc continuer, comme on l'a toujours fait ici, à construire des décors vivants et réels. Parce que je respecte profondément les hommes et les femmes qui créent ces mondes en y mettant tout leur savoir-faire et en vous ouvrant des espaces de rêve...»