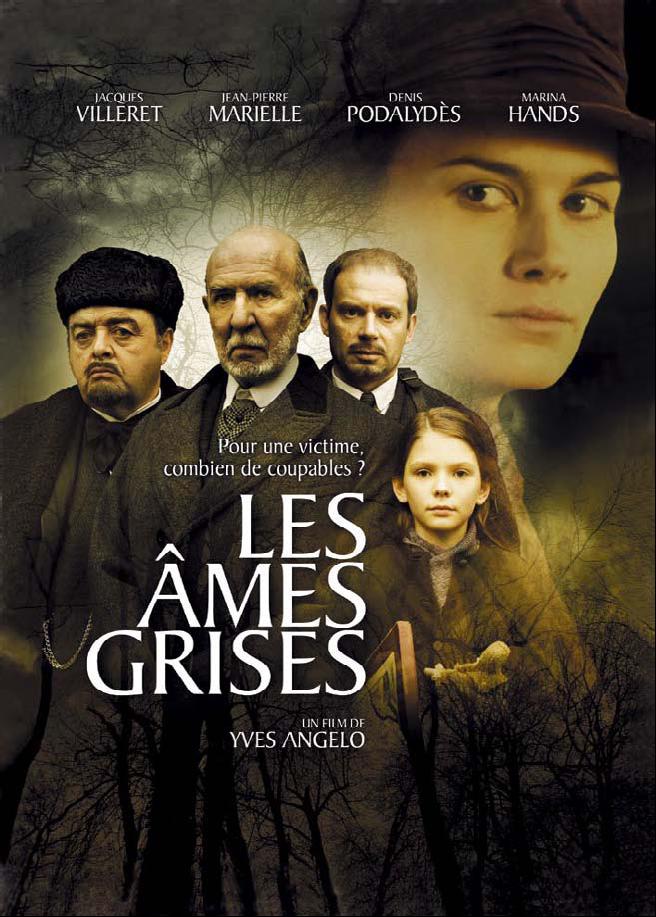
Genre : Drame, Policier
Date : 28 septembre 2005
Durée : 1 h 46
Origine : Français
Distribution : Warner Bros
D'après l'oeuvre de : Philippe Claudel
Acteurs :
Jean-Pierre Marielle : Destinat
Jacques Villeret : Le juge Mierck
Marina Hands : Lysia
Denis Podalydes : Le policier
Michel Vuillermoz : Le maire
Serge Riaboukine : Bourrache
Thomas Blanchard : Le Floc
Agnès Sourdillon : Joséphine Maulpas
Nicole Dubois : Barbe
Franck Manzoni : Colonel Matziev
Joséphine Japy : Belle de jour
Musique : Joanna Bruzdowicz
Chef décorateur : Loula Morin
Chef monteur : Thierry Derocles
Costumes : Pascaline Chavanne
Dialoguiste : Philippe Claudel
Scénario :
Yves Angelo
Philippe Claudel
Producteur :
Frédéric Brillon
Gilles Legrand
Production :
Epithète Films
France 2 Cinéma
Directeur de production :
Lieux de tournage :
Budget :
Site officiel : France : http://wwws.warnerbros.fr/lesamesgrises/
Récompenses :
Fiche du film complète (image, résumé, note de la production, avis) au format PDF à disposition sur demande, voir page d'acceuil
Paris 1830.
L’hiver 1917, dans une petite ville de l’est de la France.
Les massacres dans les tranchées sont tout proches. Des soldats
défilent, en route vers le front, conscients d’aller vers
l’horreur face à la lente procession des mutilés
et des estropiés qu’ils croisent sur leur chemin.
Une petite fille de dix ans est retrouvée noyée. Elle s’appelait Belle de jour et elle portait bien son joli nom. Autour de ce fait divers, plusieurs personnages inquiétants vont se croiser : Destinat, le procureur mystérieux, grand bourgeois austère qu’on a vu le soir du meurtre, le juge Mierck, cynique même dans les pires circonstances et le colonel Matziev, son inquiétant acolyte.
Effaré par ce qu’il découvre, un policier enquête, tout en vivant un drame personnel... Les visages de quelques femmes vont éclairer faiblement les abîmes où il descend : Clémence, sa compagne qui attend un enfant ; Clélis, l’épouse disparue du procureur ; Belle de jour, la victime innocente. Et Lysia, la lumineuse institutrice, dont le passage dans ce monde de folie sera si bref...
Sur Philippe Claudel
Mes centres d’intérêt ont souvent été
périphériques au cinéma. Et pour les scénarios,
l’expérience m’a amené à préférer
choisir mes collaborateurs chez des personnes qui n’ont rien à
voir, professionnellement, avec le cinéma. Ils ont un regard particulier
sur le concept même de scénario et une distance qui m’a
toujours semblé intéressante. Philippe m’avait fait
lire les cent premières pages des "Âmes Grises",
à une époque où l’histoire n’était
pas encore développée. Il n’était même
pas sûr de poursuivre ce début de roman. Mais j’ai tout
de suite été troublé par l’atmosphère.
Je ressentais comme une impression d’enfermement dans une pièce
dont les murs deviendraient
poreux à une moisissure qui, peu à peu, envahirait tout.
Philippe Claudel a laissé son texte pendant un an, puis il l’a
repris. Je l’ai lu. Deux ou trois semaines après, j’ai
eu envie d’en faire un scénario. J’ai commencé
une vingtaine de pages et il s’y est remis, pour écrire un
scénario. Le script était prêt six mois avant la sortie
du livre.
La production
On a proposé le scénario à un producteur, qui l’a
fait lire à quelques autres. Refus unanime. Trop sombre. Trop de
morts. Et puis Frédéric Brillion et Gilles Legrand d’Epithète
Films l’ont lu et ont eu le désir de monter le projet, mais
ça n’a pas été facile, à cause du sujet
bien sûr, et aussi à cause de moi, dont les derniers films
n’ont pas été des succès. On a tourné
46 jours, le film faisait 2h20 au premier bout à bout. Environ
30 minutes ont été coupées, très peu de séquences
enlevées, mais plusieurs scènes ont été raccourcies,
pour quelques unes avec difficulté.
Les thèmes du film
On ne montre pas le front (la présence de la guerre n’est
montrée qu’à travers le son de la canonnade, les masques
à gaz des enfants à l’école et la présence
constante des soldats revenant du front ou y partant) mais l’histoire
n’a de résonance que dans ce contexte, qui est capital, que
ce soit le conflit 14-18 ou un autre. Encerclés par l’horreur,
les habitants de ce village sont confrontés à la fois à
un crime majeur - la guerre – et à un meurtre ordinaire.
Il y a comme l’acceptation silencieuse d’une certaine forme
du Mal, et pas d’une autre. (Lorsque éclate un conflit lointain
et meurtrier, avec plusieurs dizaines de morts quotidiennement, tout ça
devient bien vite quelque chose de banal, les exemples ne manquent pas,
en ce moment même !) L’histoire pose cette question. uel est
le prix d’un être humain ? Et est ce un prix égal pour
tous ? Certainement pas. Elle montre aussi que chacun se débat
avec sa propre histoire, et uniquement avec sa propre histoire, chaque
peuple comme chaque individu.
La culpabilité
La culpabilité vient-elle du désir de commettre la faute
ou de passer à l’acte ? Autour de cette zone floue, la place
peut être immense. Tout est basé sur cette interrogation.
Et personne ne peut répondre. On peut dire que Destinat avait ses
raisons pour supprimer ces deux femmes. Mais peut-être le hasard
a-t-il aidéson désir à se réaliser, pour l’institutrice
comme pour la petite fille. Car rien dans le film n’établit
de certitudes. On voit la marque au cou de l’institutrice, et Destinat
tient le lacet. Il a caressé la joue de l’enfant le soir de
sa mort, en la croisant par hasard au bord du canal. Ce n’est sûrement
pas suffisant pour le donner coupable, mais peut-être l’est-il
vraiment,
comme le soldat déserteur peut l’être aussi. Peut-être
ce procureur est-il allé au bout d’une idée absurde,
qu’il exprime avec ces phrases récurrentes : « Elle
n’a pas connu la laideur », « Le mal n’a pas eu
le temps de l’approcher… » Mais l’histoire n’a
pas de sens si on connaît le coupable. Même le comédien
ne devait pas se dire « Je l’ai tuée » ou «
Je ne l’ai pas tuée. »
Destinat
Destinat, de toute façon, n’est pas clair. Même s’il
n’a pas commis les meurtres, il a volé les lettres, caché
le carnet de l’institutrice au policier, et y a collé ces
photos des trois visages de femme… Finalement, entre ce vieil homme
notable très brillant et le petit soldat qui était un violeur,
la rontière est mince. On découvre que,au delà des
racines, de l’intelligence, du hasard de la naissance, il y a, quelque
part dans l’âme humaine, des profondeurs qui
se rejoignent. Destinat aurait été différent si la
viene lui avait pas enlevé ce qu’elle lui avait donné,
et que l’on comprend d’une certaine façon quand on découvre
le tableau dansson château : ces visages de femme côte à
côte, ces figures qu’il ressasse comme un cauchemar obsessionnel.
Enfermé dans sa solitude, il lit le carnet volé à
l’institutrice avec une certaine complaisance, même pour s’y
entendre appeler « Tristesse ». Comme un rêve, un étrange
rêve d’imaginer sa femme (qui ressemblait si étrangement
à cette institutrice au point que celle-ci apparaisse comme son
double) lui parler d’outre-tombe à travers le visage et la
voix d’une autre. Cet aristocrate dans sa grande maison a un côté
décadent, un peu désuet : ce vieil homme dans cette salle
vide, avec des draps sur les fauteuils... Le château est à
son image : il s’effrite un peu. Entre les prises, Jean-Pierre Marielle
disait parfois : « Comme c’est dur d’être cet homme
là ! »
Mierck
Le personnage apparaît d’emblée comme une ordure, un
notable salopard, ce qui n’ôte rien à sa grande intelligence,
même utilisée parfois de façon perverse. Il est toujours
voyeur de quelque chose, afin de poser ou non son empreinte, à
sa guise. Sa victoire sur Destinat vient de ce qu’il le laisse en
dehors de l’enquête, uniquement pour savourer le fait de le
lui dire. Savourer le pouvoir qu’on a sur quelqu’un sans le
faire tomber, c’est sûrement un plaisir suprême. Il a
son idée de la justice, liée peut-être aussi à
une forme de justice de classe. En s’acharnant sur ces deux déserteurs,
il pense ne commettre aucune faute, car pour lui ils ne sont que de la
racaille. D’ailleurs il
est troublant qu’il ne se soit pas trompé puisqu’on découvrira
que l’un des deux était bien une crapule.
Le policier et la scène finale
Pour l’expliquer, j’ai besoin de résumer l’ensemble
: nous sommes dans un contexte de guerre, avec une jeune institutrice
qui a toute la vie devant elle, qui veut se rapprocher de l’homme
qu’elle aime, alors qu’il est mort ; un vieux monsieur qui lui
cache cette mort ; une petite fille assassinée ; des rapports entre
notables exécrables, toute une gangrène qui ne cesse de
croître… Un policier doit mener une enquête. Il est un
peu lâche, un peu minable. Il vit avec sa femme, qui attend un enfant…
Ça pourrait être la seule image de bonheur du film. Eh bien,
la destinée le rattrape comme les autres, en semblant lui dire
: « Tu n’es pas à l’écart de tout ça.
Tu ne vas pas à la guerre alors que ton frère y va. Tu te
planques un peu, mais je vais t’avoir, toi aussi. » On avait
cru apercevoir un peu de lumière, et tout bascule à nouveau.
Il perd sa femme, et se retrouve seul avec ce bébé. Ce bébé,
il n’en veut pas, c’est évident puisqu’il n’a
même pas été le chercher. On le lui ramène.
Dans le livre, il tue son enfant qui lui rappelle trop sa femme, comme
Destinat a pu tuer l’institutrice et la petite parce qu’elles
lui rappelaient la sienne. Dans
un premier scénario, nous avions gardé la scène,
où juste après le meurtre de son enfant, il expliquait tout
au médecin, qui comprenait et ne le dénonçait pas.
Nous avons renoncé à garder cette fin parce que l’image
pouvait verser dans la complaisance. Il était plus intéressant
(et Philippe Claudel ne s’y est jamais opposé) que l’histoire
finisse en revenant sur un être comme nous sommes tous au départ,
un bébé qui vient de naître, qui ne connaît
rien, qui est au tout début… mais au début de quoi
? Qu’est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde va l’amener à
faire ? À la fin de chaque désastre humain le monde crie
toujours que cela ne se reproduira jamais plus, et tout ça recommence
avec une régularité effrayante.Ce policier prend son bébé,
le pose, recule et ensuite s’avance. Cette avancée est comme
un point d’interrogation. Non pas de ce qu’il va faire, peu
importe. Cette avancée vers le bébé est notre avancée
à nous, vis à vis de cet être tout neuf. Le film nous
a montré ce qu’on a fait des êtres « neufs »,
tout au long de l’histoire de l’humanité : souvent une
barbarie, je parle là bien sûr à l’échelle
de l’histoire
de l’humanité. Un éternel recommencement. Il ne faut
pas oublier que le film démarre aussi sur un enfant mort. Et il
se termine sur un bébé qui tend les bras, puis les repose.
Il appelle, comme tout le monde appelle. Puis il repose ses bras. Qui
sera capable de l’entendre ?
Les silences.
Je ne pense pas que la parole soit superflue, mais souvent elle ment,
alors que les regards et les silences ne mentent jamais. Quelque part,
les mots appauvrissent. Le silence, c’est la mise à nu, c’est
le miroir, la face cachée, la lumière… La relation
de Destinat avec l’institutrice est la plupart du temps muette, comme
une relation avec un fantôme, un souvenir ou un rêve. Mais
dans le même temps, ce silence est aussi justifié par le
fait qu’il lui cache la mort de son amant (Comme aussi, d’une
certaine façon, le juge Mierck cache à la justice la rencontre
du procureur avec l’enfant le soir de sa mort). Le silence peut aller
jusqu’au malaise, tout en pouvant aussi aller jusqu’à
une grande fusion. Et quand il y a fusion, le dialogue devient superflu.
J’ai toujours été attiré par les temps «
morts », où l’on croit que rien ne se passe alors que
c’est le contraire. Quand lors du dîner Destinat lève
la main pour empêcher l’institutrice de parler, il ne fait
que traduire cela, et quand il la regarde écrire à son amant
déjà mort sur le bord du canal également.
L’institutrice
À la lecture du livre, certains la voyaient fluette et blonde.
J’ai préféré lui donner des yeux sombres pour
ne pas tomber dans le côté icône diaphane des héroïnes
qui sont par nature l’incarnation de la lumière. D’une
certaine manière, ce personnage porte aussi le même égoïsme
que les autres, parce qu’elle reste prisonnière de sa propre
histoire. Quand elle embrasse le soldat mutilé dans la rue, elle
rejoint par là davantage son amant que la douleur
d’un être humain. Quand elle pleure sur le promontoire face
à l’image des combats des tranchées, elle ne pense
qu’à son amant, et non à tous les autres. Quand aussi
elle demande aux enfants dans la classe d’écrire à
leurs pères elle ne fait que prolonger à sa manière
sa pensée obsessionnelle vers son amant. En vérité,
elle n’est pas comme le supposait et le ressentait la petite élève
dans la cour de l’école une héroïne de roman,
(ou alors seulement, par anticipation, par rapport à sa fin tragique,
qu’elle soit due au suicide ou à un meurtre) mais elle fait
partie, à sa manière, de la même déclinaison
de personnages qui jalonnent cette histoire et qui nourrissent, en vérité,
davantage le
récit du film que ne le fait l’enquête sur le meurtre.