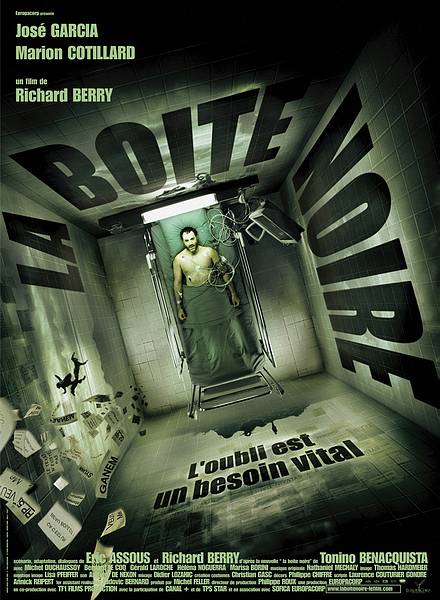
Genre : Thriller
Date : 02 Novembre 2005
Durée : 1 h 30
Origine : Français
Distribution : EuropaCorp Distribution
D'après l'oeuvre de : Tonino Benacquista
Acteurs :
José Garcia : Arthur
Marion Cotillard : Alice
Michel Duchaussoy : le père d'Arthur
Bernard Le Coq
Héléna Noguerra
Dominique Bettenfeld
Marysa Borini
Gérald Laroche
Joséphine Berry : La jeune fille bord de mer
Marilou Berry : La réceptionniste de l'hôpital
Pascal Bongard : Clovis
Hugo Brunswick : Yvan (ado)
Thomas Chabrol : Thierry
Pascal Delaunay : Le flic de l'hôpital
Alexandre Donders : Le patron du café
Françoise Geier : La maîtresse d'école
Quentin Grosset : Un élève
Lise Lamétrie : La gardienne
Pierre-Ange Le Pogam : Colbert
Arnaud Maillard : Le petit ami de Koskas
Nathalie Nell : Docteur Brenner
Philippe Roux : Le 2ème Policier
Olivier Vitrant : L'agresseur
Manon Grosset : Une eleve
Directeur
Photo : Thomas Hardmeier
Musique : Nathaniel Mechaly
Chef décoration : Philippe Chiffre
Costumes :
Valérie Ranchoux
Christian Gasc
Montage : Lisa Pfeiffer
Effets Spéciaux
: Richard Guille
Casting : Valerie Espagne
Maquillage :
Cédric Chami : styliste coiffure
Lucía Bretones-Méndez : artiste maquillage
Son
:
Lohengrin Braconnier : assistant mixeur musique
Didier Lozahic : mixeur post-synchro
Amaury de Nexon
Jérôme Devoise : mixeur musique
Zacharie Naciri : assistant monteur
Arthur Le Roux : assistant
Scénario
:
Richard Berry
Eric Assous
Producteur : Michel Feller
Directeur de la Production : Philippe Roux
Production : EuropaCorp
Assistant réalisation :
Ludovic Bernard : premier assistant
Christel Bordon : 3ème assistant
Stéphane Malhuret : second assistant
Lieux
de tournage :
Budget :
Site officiel : http://www.laboitenoire-lefilm.com/
Récompenses :
Il se réveille douloureusement dans un lit d'hôpital après un court coma. L'infirmière de service, est là pour l'accueillir. Arthur a abondamment parlé pendant son coma.
Avant de quitter l'hôpital, elle lui remet un carnet noir dans lequel elle a noté les phrases incohérentes du délire verbal d'Arthur. Ces phrases et ces mots semblent lui venir d'un monde intime qu'il ne comprend pas. Les découvertes qu'il va alors faire sur lui-même vont faire basculer ses convictions les plus profondes...
En chacun de nous, il existe trois personnes
En chacun
de nous, il existe trois personnes : celle que l’on voudrait être,
celle que l’on croit être et celle que l’on est vraiment…
Pour le héros de La Boîte noire (2004) et les secrets qui
le hantent, l’heure de la rencontre a sonné.
A la suite d’un accident, Arthur se trouve confronté à
une zone d’ombre de son esprit. Parce qu’une infirmière
a noté tout ce qu’il disait pendant sa phase de réveil
post-coma, il va avoir accès à son inconscient –
sa boîte noire. Pour lui, il est enfin temps d’affronter
ce qui l’empêche de vivre, de découvrir les secrets
des vraies blessures de son enfance. Cette incroyable quête va
changer sa vision du monde en l’amenant au bout de lui-même…
Thriller atypique et envoûtant, La Boîte noire (2004) nous
entraîne au plus profond d’un esprit, à la poursuite
d’une vérité qui nous concerne tous…
Richard Berry,
scénariste et réalisateur de La Boîte noire (2004)
confie : « Je me suis énormément documenté
sur les comas, les traumatismes cérébraux, mais aussi
sur les phénomènes psychiques et psychologiques associés.
Je me suis plongé dans les livres de neurochirurgiens et de neuropsychiatres,
en particulier celui écrit par Hélène Oppenheim-Gluckman,
“Mémoire de l’Absence”, une référence.
Elle s’est spécialisée dans l’étude des
sorties de coma, s’intéressant à ce que les gens
racontent jusqu’au délire dans ces moments-là et
à ce que cela a changé en eux. Sa première constatation
est tout simplement fascinante : quelle que soit la durée du
coma, celui qui en sort est toujours le même. Il ne perd jamais
son identité. Tous les rouages sont en place. Ce qui définit
l’être est intact, mais son rapport au monde peut se trouver
modifié. Il peut ne plus reconnaître ses proches ou des
lieux. Il les réappréhende alors de façon complètement
neuve. C’est un point de départ fabuleux pour tenter de
cerner ce qui structure notre esprit et conditionne notre vie.
« Autre fait remarquable, la phase d’éveil est, sauf
cas extrêmes, toujours égale à deux fois la durée
du coma. Et dès que l’on est complètement réveillé,
on oublie tout ce que l’on a pu faire ou dire pendant cette phase.
Pourtant, durant cette période, notre esprit vagabonde librement
dans des zones qu’il ne peut jamais visiter durant notre état
”normal”. La boîte noire est alors ouverte…
« On est tout à coup en contact direct avec notre inconscient,
là où est stocké tout ce que l’on croit –
souvent à tort – avoir oublié, comme les traumatismes.
On sait, comme le rappelle d’ailleurs un des personnages du film,
que l’oubli est un besoin vital. Pourtant, parfois, dans cette
mémoire cachée, se dissimulent certaines des réponses
essentielles qui expliquent nos difficultés à vivre. Il
ajoute également que tout ce qui se dit pendant la phase d’éveil
équivaut largement à quinze d’analyse.
« C’est un neurochirurgien, le professeur Truelle, qui m’a
déclaré qu’il existait trois personnes en nous. Je
me souviens que lors d’un de nos entretiens dans son bureau, il
y avait beaucoup de bruit et de cris dans le couloir. Une personne était
en train de jurer, de vociférer des insanités avec une
voix rauque, comme dans le film. Il s’agissait d’une femme,
dans sa phase de réveil. Elle avait reçu un choc sur le
lobe orbito-frontal, siège des inhibitions. Il n’est pas
rare que des accidents de voiture provoquent ce genre d’effets.
Le choc est désinhibiteur, et c’est assez spectaculaire.
Comme pour mon héros, les verrous sautent, il n’a plus de
pudeur, il dit tout ce qu’il pense, c’est assez jubilatoire
! »
Richard Berry
raconte : « Juste après avoir découvert le premier
montage de Moi, César, Luc Besson m’a dit que je devrais
faire un film noir, un thriller qui me permettrait d’exploiter
les images et la mise en scène qu’il y pressentait. J’ai
d’autant plus réfléchi à sa remarque que j’avais
moi-même envie d’aller dans ce sens. Il n’y avait d’ailleurs
pas de rupture de sujet entre Moi, César et La Boîte noire
(2004) car si la forme diffère, les deux traitent toujours d’une
quête d’identité. La Boîte noire (2004) repose
sur une clef de l’enfance qui bloque un adulte, alors que l’enfant
de Moi, César parle par la voix de l’adulte que j’étais
alors. Je n’avais donc pas un grand pas à franchir pour
écrire ce nouveau film. « Pendant deux ou trois mois, j’ai
commencé l’écriture d’un thriller sur l’identité
et puis un jour, ma fille m’a dit que mon sujet lui rappelait une
nouvelle de Tonino Benacquista, “La Boîte Noire”. Je
l’ai lue et j’ai été très intéressé
par son idée de départ – un homme qui fait des recherches
à partir des notes prises par quelqu’un d’autre sur
ce qu’il a dit pendant sa phase d’éveil. »
Michel Feller, producteur du film, intervient : « A partir de
cette idée de base, Richard et son coscénariste, Eric
Assous, ont construit leur propre histoire. Parce que Richard n’a
jamais perdu de vue ni le fond ni la forme, il a réussi à
créer un film qui est à la fois un thriller sur l’inconscient
et un vrai film d’auteur tourné comme un film d’action.
»
Le producteur ajoute : « La Boîte noire (2004) vous captive,
vous interpelle, et le scénario apporte en plus un côté
ludique en montrant différentes interprétations d’un
même personnage. Le film aborde les traumas, le sentiment de culpabilité,
le langage propre à l’inconscient qui guide nos faits et
gestes et peut nous rendre étranger à nous-même.
Mais au-delà de l’enquête que livre le héros,
le film raconte son parcours vers la lumière, vers la liberté.
»
Michel Feller commente : « C’est le second film que je fais
avec Richard. L’expérience et le travail ne servent qu’à
diminuer les filtres, les modifications successives qui peuvent s’interposer
entre le geste qu’un réalisateur a dans la tête et
le geste qu’il accomplit finalement. »
Richard Berry
explique : « Ce scénario a été difficile
à écrire. Il fallait développer un thriller dont
la construction s’apparentait à un puzzle, tout en assurant
la cohérence d’un sujet très particulier. Pour mettre
les éléments en place, il m’a fallu sept à
huit mois. Puis, pendant les six mois qui ont suivi, j’ai peaufiné,
retravaillé les dialogues.
« Par rapport à l’histoire, deux paramètres
étaient primordiaux pour moi. Je voulais d’abord que tout
soit crédible d’un point de vue médical. A la phase
d’écriture proprement dite, il m’a donc fallu ajouter
des heures de recherches, de rencontres passionnantes, pour vérifier
chaque point.
« L’autre paramètre était davantage d’ordre
scénaristique. Avant d’assumer ce qui lui arrive, le personnage
tente des échappatoires – l’hypnotisme, la drogue…
Toutes ces portes ne mènent nulle part, je les ai fermées.
Il épuise ses recours extérieurs jusqu’à être
obligé de chercher les réponses en lui-même. Il
n’a pas d’autre choix que d’affronter. C’est aussi
l’un des messages du film. La peur est souvent ce qui nous empêche
de faire face. On fuit, on évite, et rien n’est résolu.
J’ai pensé que le fait d’assumer est libérateur.
C’est l’un des thèmes qui me touchent, je l’abordais
déjà dans Moi, César. Je suis convaincu que tout
le monde peut y arriver. Sous cet angle, La Boîte noire (2004)
est aussi une fable. Certains pourront y voir un thriller original,
mais d’autres y sentiront aussi des interrogations qui trouveront
un écho au plus profond d’eux. Tout le monde a sa boîte
noire. »
Le réalisateur précise : « Les sujets qu’aborde
le film sont éternels. Je ne l’ai pas fait de façon
consciente mais je m’en suis rendu compte a posteriori. Il est
question de culpabilité, de celle que l’on génère
et de celle que l’on subit. Il est aussi question des thèmes
les plus emblématiques qui sont à la base de la psychanalyse
: le sexe, l’argent et l’importance fondatrice de l’enfance.
»
José Garcia
Richard Berry
se souvient : « En écrivant, je n’avais pas encore
pensé à José, et c’est en parlant avec Luc
Besson que son nom s’est imposé. José a immédiatement
accepté avec un enthousiasme qui ne s’est jamais démenti
par la suite. Il a été constamment à 300 % dans
le film et avec moi. C’est le plus beau cadeau qu’un acteur
puisse faire ! Je lui ai demandé beaucoup et il a toujours tout
donné. Il habite le film. »
Michel Feller intervient : « Nous avions besoin d’un acteur
populaire – dans le bon sens du terme – auquel le public pourrait
s’attacher. Cet homme “normal” devient notre guide dans
un voyage extraordinaire. José porte en lui cette capacité
de jouer avec la même intensité le drame ou la comédie.
»
Richard Berry reprend : « Nous avons beaucoup discuté du
personnage afin qu’il saisisse complètement tous les aspects
de l’histoire. Nous avons fait trois lectures complètes
pendant lesquelles je lui ai donné toutes les indications possibles.
Ensuite, cela s’est joué au quotidien. José me disait
“Avec toi, c’est simple, il me suffit d’apprendre mon
texte et après, tu m’embarques !”.
« Les scènes ont très souvent été
tournées dans la continuité pour qu’il puisse s’immerger
totalement. José savait que le tournage serait dur, mais c’est
un acteur fantastique capable de faire des choses extraordinaires. J’ai
essayé de le pousser au-delà de ses limites. J’ai
tout fait pour lui en donner les moyens. Je me souviens que par exemple,
pour la scène où il arrive dans le bureau du docteur,
bouleversé de ne pas pouvoir aller voir sa psy, il avait beaucoup
de mal. Il ne parvenait pas à avoir la fébrilité
nécessaire. Je lui ai alors raconté ce qu’on disait
à propos de Michel Simon : “quand il entre en scène,
il a l’air d’en sortir”, et je lui ai demandé
de jouer la scène comme s’il en sortait ! »
Michel Feller
déclare : « Il ne faut pas avoir peur de mettre les comédiens
là où on ne les attend pas. »
Richard Berry explique : « Le film est particulier et nécessitait
de chacun un engagement complet et complexe. José a été
le premier engagé, mais autour de lui devait évoluer toute
une galerie de personnages.
« Marion Cotillard est un cadeau. C’est une actrice que j’adore.
Elle investit ses personnages, les incarne dans toute leur profondeur,
elle est passionnante, belle, humaine. Son enthousiasme pour le scénario
et pour le film ne s’est jamais démenti non plus. Pour chaque
scène, on peut lui demander le plus petit détail, le moindre
froncement de sourcil. C’est un bonheur total !
« J’ai toujours vu chez Héléna Noguerra un
potentiel remarquable qui, au-delà de sa beauté, ne me
semblait pas du tout avoir été exploité. Pour elle,
je voulais un personnage plus fatal, plus dramatique, une beauté
redoutable. Je crois que son rôle la révèle enfin
dans toute sa dimension.
« Depuis toujours, j’apprécie Michel Duchaussoy, avec
qui j’ai joué à la Comédie-Française.
Je m’étais juré de travailler un jour avec lui. Tout
comme j’espère vraiment le faire avec des gens comme Michel
Aumont ou Jean-Pierre Marielle. Michel Duchaussoy est le seul comédien
que j’avais en tête dès l’écriture. Son
rôle est essentiel, c’est l’une des clefs.
« Je connaissais Gérald Laroche dans des rôles assez
sombres, mais j’avais du mal à l’imaginer dans un personnage
plus doux. Lorsqu’il a passé ses essais, j’ai tout
de suite vu qu’il en était capable. Il avait en plus une
très grande disponibilité et une vraie gentillesse. Il
avait envie de faire le film, et il était désormais clair
qu’il pouvait donner vie à toutes les dualités de
son personnage.
« Bien que n’ayant travaillé qu’une seule fois
avec Bernard Le Coq, je le connaissais bien et j’apprécie
vraiment sa façon de jouer. Il ne fait jamais de numéro
pour la caméra, il devient son personnage et le fait exister.
Son jeu est très intérieur. Son registre est très
large et il a ici l’occasion de l’utiliser sous de nombreux
aspects. »
Quelque part entre le rêve et la réalité
Richard Berry
explique : « L’univers visuel du film était un enjeu
primordial. La phase de préparation a été deux
fois plus longue que pour un film normal, tellement les différents
départements avaient besoin d’être parfaitement coordonnés.
Qu’il s’agisse de la photo, des décors ou des costumes,
tout le monde a travaillé en parfaite harmonie.
« Pour maîtriser l’image et parvenir à la texture
que je souhaitais, j’ai travaillé avec le directeur de la
photo dès l’écriture. Je lui ai raconté le
sujet, lu des pages du scénario pour commencer à anticiper
le traitement de l’image – dans une désaturation pour
la première partie, puis une saturation plus poussée pour
la seconde. L’étalonnage numérique nous a permis
de traiter les couleurs des décors sans perdre les vraies couleurs
des visages. C’était essentiel.
« Pour les décors, il y a eu aussi un énorme travail
sur les couleurs. Tous les costumes – même les blouses dont
les couleurs devaient se fondre dans la palette du film – ont été
faits sur mesure. Cela permettait de rendre le film intemporel. Aucun
élément ne permet de le dater précisément.
Les costumes, les meubles, tout évoque une époque imprécise.
Je souhaitais cela pour emmener le film sur le terrain de la fable,
loin du temporel.
« L’esthétique du film s’est définie instinctivement
en moi dès l’écriture. Ce qui allait être filmé
était aussi important que la façon dont j’allais
le capter sur la pellicule. Je souhaitais un climat hypnotique, des
mouvements de caméra affranchis des contingences matérielles.
Ils devaient être efficaces et liés à la signification
de l’action. Nous avons joué sur tous les éléments,
y compris sur la forme des lieux. Certaines variations seront plus ressenties
que vues par les spectateurs. C’est vrai de l’appartement
d’Arthur et de celui de son frère. Nous avons même
été jusqu’à faire varier la largeur du couloir
suivant les périodes pour influencer la perception inconsciente
des lieux. La deuxième partie à l’hôpital est
un autre exemple. La couleur des draps est un peu plus vive. La chambre
d’hôpital n’a plus la même forme. Des arbres apparaissent
à la fenêtre qui, dans la première partie, est munie
de barreaux pour suggérer l’enfermement. Le film va vers
la lumière. C’est le parcours d’un homme enfermé
dans ses doutes et sa culpabilité, qui va peu à peu vers
une vérité. Il enquête sur lui-même pour se
comprendre et se libérer. »
Michel Feller
intervient : « La Boîte noire (2004) est un film très
pointu sur le plan technique. Film d’auteur filmé comme
un film d’action, il a nécessité de nombreux mouvements
d’appareils, des séquences de cascade au bord d’une
falaise avec des enfants, des câbles, des accidents de voiture,
le tout en extérieur avec parfois des tempêtes de vent…
De nombreux décors ont été construits en studio,
comme les appartements et certaines salles de l’hôpital.
Dans ces décors, Richard bénéficiait d’une
liberté de mise en scène, de mouvement. »
Le producteur poursuit : « Le tournage a duré 60 jours,
à Paris, aux studios d’Epinay et dans les environs de Cherbourg.
Face à la météo qui a souvent joué contre
nous, le tournage sur la falaise n’a pas été simple.
Nous devions tourner en extérieur pour l’ambiance, l’authenticité,
mais toutes les actions exigées par le scénario auraient
justifié la sécurité d’un studio. Alors, nous
avons cumulé, nous avons fabriqué un bout de falaise pour
obtenir le surplomb, nous l’avons entouré de fond bleu,
et il y a aussi eu les grues et les câbles… »
Richard Berry raconte : « Lesscènes les plus compliquées
ont toutes été découpées et storyboardées.
La falaise a été un cauchemar. Le premier jour, la Technocrane
est tombée en panne tellement le vent soufflait fort. Le lendemain,
celle envoyée en secours a elle aussi lâché. Il
en a fallu une troisième pour arracher le plan et ce jour-là,
petit miracle, la lumière était plus belle que jamais.
Il faut saluer la production et Luc en particulier, qui m’a toujours
donné ce dont j’avais besoin. Il est agréable d’avoir
un producteur qui soit aussi metteur en scène, pour savoir qu’un
plan peut nécessiter trois grues sans se borner au coût
de l’opération. Mais ces plans valaient la peine. »
Michel Feller précise : « Pour une scène, nous avons
dû tout simplement vider des rues entières de Paris afin
que José puisse marcher dans une ville sans véhicules
et sans passants. Le résultat est surréaliste et fascinant.
Il y a très peu de figurants dans le film. Tous les personnages
visibles sont des rouages de l’histoire. »
Richard Berry reprend : « Une fois que l’environnement dans
lequel les comédiens vont jouer est prêt, je me consacre
à eux. Je leur donne ce que je pense bon pour le film, en essayant
de leur parler comme j’aurais aimé qu’on me parle.
»
« En tant que metteur en scène, je m’efforce de valoriser
leur potentiel, ce que j’aime en eux et ce qui m’a poussé
à les choisir. »
Il ajoute : « J’ai rêvé de ce film et j’ai
tout fait pour le concrétiser comme je le voyais. Je pense qu’au
départ, tout le monde imaginait un thriller décalé,
mais que le climat particulier du film, son autre niveau de lecture
que j’avais voulu, ne sont apparus à tout le monde qu’ensuite.
Je crois avoir fait exactement le film que je voulais faire. »
Richard Berry
confie : « Ce que j’aime, c’est raconter une histoire
qui parle aux gens. J’espère, à travers ce film,
leur faire passer un bon moment, les surprendre, les intéresser,
mais aussi les pousser à se poser des questions, à s’intéresser
à eux-mêmes. Si La Boîte noire (2004) peut seulement
aider les gens à prendre conscience qu’il y a en eux une
boîte noire et qu’elle contient probablement ce qui peut
les gêner dans leur vie, alors j’en serai très heureux.
J’ai envie de leur donner quelques modestes moyens pour découvrir
leurs propres clefs, et peut-être se libérer d’une
partie de leurs souffrances. Jusqu’à présent, les
témoignages que j’ai eus me confortent, particulièrement
chez les jeunes qui sont très sensibles aux thèmes du
film.
« Tout ce que j’ai vécu m’a servi à structurer
ma pensée, à devenir un vrai réalisateur. J’ai
l’impression, la sensation, que j’ai enfin trouvé ma
vraie forme d’expression. C’est quelque chose que j’avais
en moi depuis toujours. »
Michel Feller conclut : « Pour moi, l’aventure de ce film
a été de soutenir la vision qu’en avait le réalisateur,
son climat, sa richesse de thèmes et sa force universelle. J’ai
aussi été saisi par l’époustouflant travail
de José Garcia. Avec très peu de mots, par l’énergie
et la tension, grâce à l’incroyable humanité
qu’il insuffle à son personnage, on s’attache à
lui. La Boîte noire (2004) est un film puissant, comme on n’a
pas l’habitude d’en voir. »
Richard Berry nous livre : « Nathaniel Mechaly, c’est une découverte. Quelques maquettes sur des images ça et là ont suffi à me convaincre qu’il y avait là un grand talent. Il a été intimement touché par le film. Les images l’ont inspiré. Il a très vite écrit un thème au piano que j’ai adoré. Il a un sens de la composition classique très solide mais il a aussi une grande modernité dans l’utilisation des sons, de l’invention. La musique du film est envoûtante, émouvante, violente parfois. Elle se fond dans les images et les met en valeur discrètement. Nathaniel est un grand musicien, je pense qu’il ira loin. »
Ce qui le
caractérise, c’est son obstination. Il court après
sa mémoire et rien ni personne ne pourra l’en empêcher.
Il veut comprendre. Pourquoi roulait-il en pleine nuit sur cette route
près de Cherbourg, où s’est déroulé
son accident ? Que signifient ses délires verbaux que l’infirmière
a notés sur un carnet noir durant sa phase de coma ? Arthur aurait
pu, comme la majorité des gens, passer le restant de ses jours
avec son inconscient à côté de lui. Il aurait pu
ne jamais se rendre compte des erreurs et des événements
qui ont forgé son caractère. Mais voilà, le destin
en a décidé autrement. Des souvenirs qu’il pensait
enfouis à jamais resurgissent par bribes. Des souvenirs datant
de l’enfance et qui, vingt-cinq ans plus tard, vont prendre une
ampleur considérable et une signification particulière.
Tout ça l’obsède, le taraude, le perturbe énormément.
D’autant que dans cette histoire, il est à la fois l’enquêteur,
la victime et le coupable présumé. Il ne peut donc compter
que sur lui-même pour recomposer le puzzle de sa vie.
Une enquête libératrice
Son enquête va obliger Arthur à revivre une deuxième
fois certaines tragédies de son existence. Je pense notamment
à la mort de son frère. C’est terrible pour lui,
ça le plonge dans une souffrance abominable. Toutefois, traverser
cette phase de douleur reste l’unique solution pour qu’il
réussisse enfin à se libérer, à évacuer
ce sentiment de culpabilité qui le ronge depuis des années.
Par ailleurs, il n’évolue pas dans une logique de vengeance,
il se refuse à juger les actes des autres. Il avait juste besoin
de crever l’abcès afin de pouvoir réattaquer une
nouvelle vie avec sérénité.
De la comédie au drame
Je choisis souvent des films qui me permettent de me diriger vers d’autres
films. Dans les nombreuses comédies que j’ai tournées,
j’ai toujours joué avec la générosité
qu’exigeait le metteur en scène, tout en croyant au maximum
à la situation et à mon personnage. Ce que j’espérais
alors, c’était de pouvoir continuer à croire tout
autant à mon personnage, mais dans un contexte plus tragique.
Philippe Harel m’a offert cette opportunité dans Extension
du domaine de la lutte. Moi, j’étais habitué à
bouger, à remplir un espace et à composer avec une caméra
qui ne venait pas forcément chercher quelque chose en moi. Là,
pour la première fois, j’ai eu la possibilité de
remplir un personnage de l’intérieur et de ne laisser voir
que ce que la caméra venait prendre. J’ai récemment
réitéré cette expérience avec Le Couperet,
de Costa-Gavras. Le spectateur pénétrait, au sens figuré,
dans la tête d’un personnage central instable. En ce sens,
je considère La Boîte noire (2004) comme une suite logique
du Couperet dans mon parcours de comédien : on y pénètre,
au sens propre cette fois, dans le cerveau du personnage.
Vitesse de jeu
Au début du film, j’avance à deux à l’heure,
incarnant un Arthur fébrile, vaseux, mais aussi complètement
parano et se méfiant sans cesse de ce que lui racontent les gens.
Dans la seconde partie, quand Arthur reprend du poil de la bête,
je dois nettement accélérer le tempo. C’est rare
et très agréable de pouvoir varier la vitesse de son jeu
en cours de film.