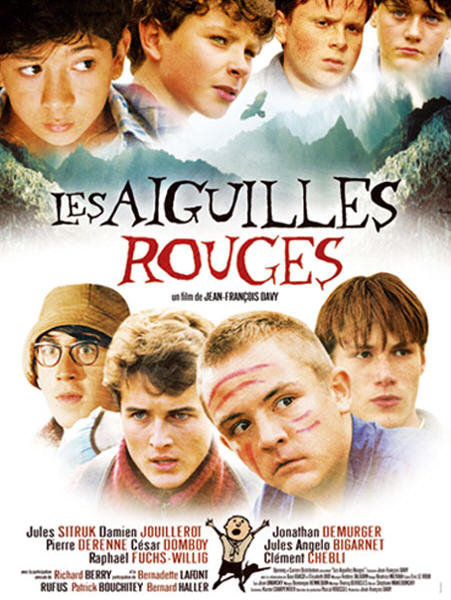
Genre : Drame
Date : 10 Mai 2006
Durée : 1 h 33
Origine : Français
Distribution : Carrère Group
Résumé | Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget
Directeur
Photo : Béatrice
Mizrahi
Musique : Frédéric Talgorn
Décors :
Chef décoration : Stéphane Makedonsky
Costumes : Karine Charpentier
Montage : Thierry Derocles
Effets Spéciaux :
Casting : Annik Dufrene
Direction artistique :
Maquillage : Frédérique Arguello : styliste coiffure et maquilleuse
Son :
Dominique Hennequin : mixeur
Jean Umansky
Production : Opening Productions
Assistant réalisation : Philippe Chapus : premier assistant
![]() Site
officiel : http://www.lesaiguillesrouges-lefilm.com/
Site
officiel : http://www.lesaiguillesrouges-lefilm.com/
| Note production | Acteurs | Scénario | Producteur | Site Officiel | Récompenses | Lieux | Budget
Septembre 1960. Patrick et sa patrouille, Les Aigles, sont en camp scout dans la vallée de Chamonix. Entre 12 et 16 ans, la hiérarchie, on ne connaît pas ! Surtout chez Les Aigles...
Adeptes de jeux dangereux, ils se retrouvent dans le collimateur du chef de troupe qui, à titre punitif, les envoie en randonnée pendant trois jours... Ils devront escalader le massif du Brévent, juste en face du Mont Blanc, 2 500 m d'altitude !
Patrick dirige tant bien que mal ce groupe de huit garçons que tout oppose : caractère, origine sociale, perspectives d'avenir... Sa patrouille et lui entreprennent donc l'escalade du Brévent. Ils emportent dans leurs sacs à dos leur inexpérience de la montagne, leur insouciance, leurs contrastes, leurs histoires de filles, la lettre d'une amie, celle d'un frère militaire en Algérie...
Les Aiguilles Rouges est un projet de dix ans, pour lequel Jean-Francois Davy s'est battu sans relâche afin de le concrétiser : "J'ai décidé de réaliser et de produire contre vents et marées cette aventure vécue à l'âge de 15 ans qui m'avait profondément marqué.(...) Personne ne semblait passionné par cette aventure de gamins perdus dans la montagne". En plus d'un travail d'écriture et de collaboration scénaristique conséquent aux côtés de Gaïa Guasti et Elisabeth Diot, le réalisateur a aussi tenu à financer lui-même son projet : "Avant les Aiguilles rouges, je n'avais pas réalisé de film depuis 23 ans ! (...) Je redémarrais dans le métier de réalisateur et il était difficile de faire adhérer les partenaires habituels du cinéma français à l'aventure".
Retrouvailles
Pour nourrir l'écriture des rôles et se remémorer
cet été passé à la montagne, Jean-Francois
Davy a décidé de reprendre contact avec ses anciens camarades.
"J'ai revu Eric et Jean-Pierre. On a dîné ensemble et
ça m'a fait un drôle d'effet. (...) Ca m'a troublé
par rapport à l'image que j'avais gardé d'eux. je n'ai donc
pas voulu renouveler l'expérience".
De la réalité à la fiction
Le scénario des Aiguilles Rouges se nourrit de l'enfance du réalisateur-scénariste,
Jean-Francois Davy. "Les évènements racontés
dans ce film ont vraiment eu lieu. Cela m'est arrivé en juillet
1960 et tout s'est précisément passé comme nous le
montre le film". Il a ainsi relaté de façon la plus
fidèle possible son été à la montagne : "A
l'époque, l'itinéraire que nous avions suivi est exactement
celui retracé à l'écran et la plupart des anecdotes
évoquées dans le film sont arrivées. Comme par exemple,
la scène où les garçons forcent la porte d'une boutique
et "empruntent" quelques marchandises. C'est la première
fois que je la raconte car, à l'époque, c'était resté
secret !".
Souvenirs d'enfance
Le tournage de ce film a permis au réalisateur de se replonger
dans ses souvenirs et d'apprendre de nouvelles choses : "Si je me
suis souvenu - heure par heure - de ces quatres journées passées
en montagne sans pouvoir fermer l'oeil, j'ai aussi appris des choses en
tournant le film. J'ai ainsi retrouvé l'un des guides qui avait
sauvé Eric et qui m'a raconté ce à quoi je n'avais
pas assisté."
Les deux Patrick
Le jeune scout de 16 ans qu'était alors Jean-Francois Davy se prénomme
Patrick dans le scénario. Durant le tournage, le réalisateur
s'est beaucoup rapproché de Jonathan Demurger qui interprète
le jeune homme. "Il s'est créé entre nous un rapport
filial, je suis devenu une sorte de père bis. (...) On s'amusait
pendant le tournage à ne se parler qu'à la première
personne (...) Nous avions une complicité formidable, comme avec
tous les autres comédiens d'ailleurs.".
Un casting de jeunes talents
Les huit jeunes héros de ce film n'ont pas tous la carrière
déjà florissante de Jules Sitruk (Monsieur Batignole ) ou
Damien Jouillerot , qui retrouve ici son partenaire de Malabar Princess,
Jules-Angelo Bigarnet. Pour Clément Chebli ou encore César
Domboy, Les Aiguilles Rouges marquent leur première expérience
cinématographique. "J'ai fait "coacher" les comédiens
qui avaient besoin de travailler plus que d'autres, pendant plusieurs
mois en amont du tournage". Le réalisateur souhaitait ainsi
créer "une réelle homogénéité"
au sein du groupe.
Un tournage éprouvant
Après l'euphorie des premiers jours, les aléas de la météo
ainsi que le danger permanent de tourner en montagne ont rendu le tournage
plus difficile que Jean-Francois Davy ne pouvaient se l'imaginer : "Le
premier jour, il a plu toute la journée... Impossible de tourner
alors que ça faisait vingt-trois ans que j'attendais ce moment
! (...) En octobre, on est rentré dans l'automne et dans le froid.
Le matin il faisait quatre, cinq degrés et il fallait malgré
tout que les gamins donnent l'impression d'être en plein été.
(...) Pour tourner certaines scènes, on a dormi en altitude dans
un refuge pendant huit jours".
Au rythme des années 60
L'action du film se déroulant au cours de l'année 1960,
l'atmosphère est rythmée par la guerre d'Algérie,
qui prend une place importante dans le récit. Elle marque ainsi
l'éveil de la conscience politique chez ces jeunes. "C'est
en 1962 que j'ai commencé à avoir un point de vue politique
; l'un de mes camarades était parti en Algérie, comme enseignant
et non pas comme militaire. Il nous écrivait, et c'est à
partir de cela que j'ai imaginé le frère de Jean-Pierre
qui combattait en Algérie. Ce camarade nous racontait que les Algériens
se battaient pour une cause légitime, qu'il fallait les comprendre..."
La place de la montagne
La montagne n'est pas qu'un simple élément de décor,
mais un personnage à part entière dans le film et a une
valeur symbolique : "A travers cette ascension, je voulais aussi
montrer le passage de l'enfance à l'âge adulte : cela consiste,
par exemple à apprendre à savoir dire non quand on vous
donne un ordre absurde".
Retour dans le passé
La troupe à laquelle appartenait Jean-Francois Davy était
composé de neuf jeunes, mais pour le besoins du scénario,
ce nombre a été ramené à huit. Par contre,
si les noms des garçons ont été modifiés,
les surnoms ou expressions de l'époque sont les mêmes : "Je
tenais beaucoup à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'identifier
avec les préoccupations de ces personnages et que leurs parents
se reconnaissent et se replongent dans cette époque avec plaisir".
Scout toujours !
Alors que le sujet du film met en évidence un été
parmi les scouts, le réalisateur n'a pas voulu en faire son thème
principal. "J'ai voulu effacer le côté "scout toujours"".
Cependant, il reste très attaché à son passé
et aux expériences vécues parmi eux : "Même si
le scoutisme n'est pas le sujet principal du film, ce mouvement a beaucoup
compté dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de
8 ans, puis j'ai été scout pendant une dizaine d'années.
J'ai d'ailleurs continué après les mésaventures des
Aiguilles Rouges".
Un été de tous les dangers
La patrouille à laquelle appartenait Jean-Francois Davy a vraiment
pris beaucoup de risques lors de cet été 1960. Le réalisateur
en a réellement pris conscience en revenant sur les lieux de la
randonnée : "Il a été alors impossible d'aller
là où l'on était passé à l'époque,
même encadré par des guides. J'ai alors pris conscience des
risques considérables qu'on avait encourus. On aurait pu tous y
passer !"